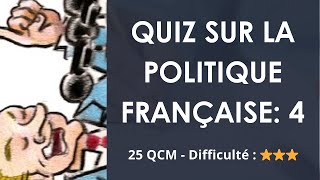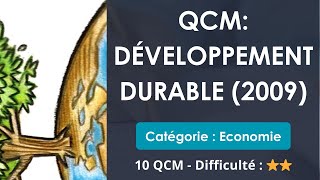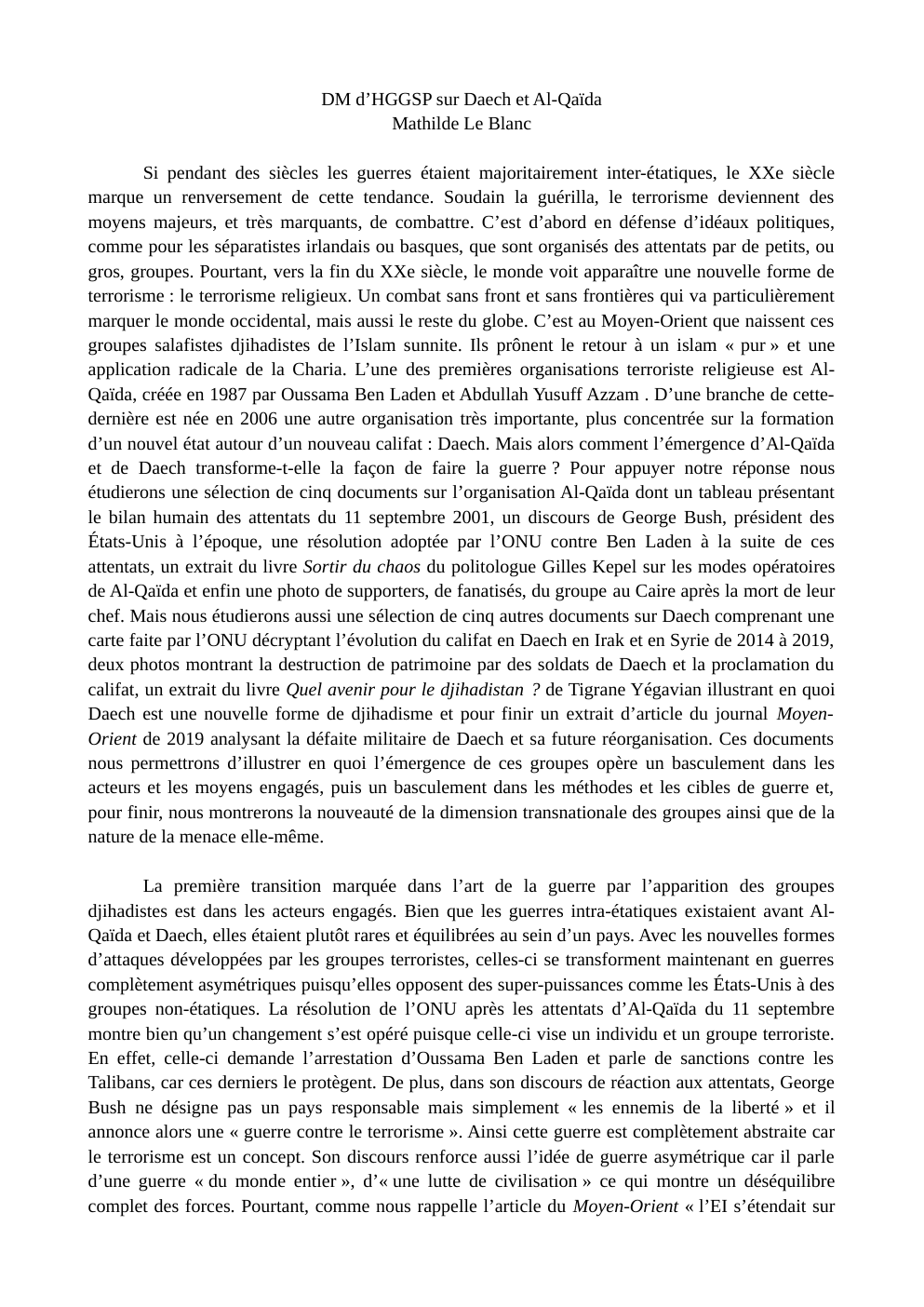Comment Al-Qaida et Daech ont-ils changé la manière de faire la guerre
Publié le 02/12/2023
Extrait du document
«
DM d’HGGSP sur Daech et Al-Qaïda
Mathilde Le Blanc
Si pendant des siècles les guerres étaient majoritairement inter-étatiques, le XXe siècle
marque un renversement de cette tendance.
Soudain la guérilla, le terrorisme deviennent des
moyens majeurs, et très marquants, de combattre.
C’est d’abord en défense d’idéaux politiques,
comme pour les séparatistes irlandais ou basques, que sont organisés des attentats par de petits, ou
gros, groupes.
Pourtant, vers la fin du XXe siècle, le monde voit apparaître une nouvelle forme de
terrorisme : le terrorisme religieux.
Un combat sans front et sans frontières qui va particulièrement
marquer le monde occidental, mais aussi le reste du globe.
C’est au Moyen-Orient que naissent ces
groupes salafistes djihadistes de l’Islam sunnite.
Ils prônent le retour à un islam « pur » et une
application radicale de la Charia.
L’une des premières organisations terroriste religieuse est AlQaïda, créée en 1987 par Oussama Ben Laden et Abdullah Yusuff Azzam .
D’une branche de cettedernière est née en 2006 une autre organisation très importante, plus concentrée sur la formation
d’un nouvel état autour d’un nouveau califat : Daech.
Mais alors comment l’émergence d’Al-Qaïda
et de Daech transforme-t-elle la façon de faire la guerre ? Pour appuyer notre réponse nous
étudierons une sélection de cinq documents sur l’organisation Al-Qaïda dont un tableau présentant
le bilan humain des attentats du 11 septembre 2001, un discours de George Bush, président des
États-Unis à l’époque, une résolution adoptée par l’ONU contre Ben Laden à la suite de ces
attentats, un extrait du livre Sortir du chaos du politologue Gilles Kepel sur les modes opératoires
de Al-Qaïda et enfin une photo de supporters, de fanatisés, du groupe au Caire après la mort de leur
chef.
Mais nous étudierons aussi une sélection de cinq autres documents sur Daech comprenant une
carte faite par l’ONU décryptant l’évolution du califat en Daech en Irak et en Syrie de 2014 à 2019,
deux photos montrant la destruction de patrimoine par des soldats de Daech et la proclamation du
califat, un extrait du livre Quel avenir pour le djihadistan ? de Tigrane Yégavian illustrant en quoi
Daech est une nouvelle forme de djihadisme et pour finir un extrait d’article du journal MoyenOrient de 2019 analysant la défaite militaire de Daech et sa future réorganisation.
Ces documents
nous permettrons d’illustrer en quoi l’émergence de ces groupes opère un basculement dans les
acteurs et les moyens engagés, puis un basculement dans les méthodes et les cibles de guerre et,
pour finir, nous montrerons la nouveauté de la dimension transnationale des groupes ainsi que de la
nature de la menace elle-même.
La première transition marquée dans l’art de la guerre par l’apparition des groupes
djihadistes est dans les acteurs engagés.
Bien que les guerres intra-étatiques existaient avant AlQaïda et Daech, elles étaient plutôt rares et équilibrées au sein d’un pays.
Avec les nouvelles formes
d’attaques développées par les groupes terroristes, celles-ci se transforment maintenant en guerres
complètement asymétriques puisqu’elles opposent des super-puissances comme les États-Unis à des
groupes non-étatiques.
La résolution de l’ONU après les attentats d’Al-Qaïda du 11 septembre
montre bien qu’un changement s’est opéré puisque celle-ci vise un individu et un groupe terroriste.
En effet, celle-ci demande l’arrestation d’Oussama Ben Laden et parle de sanctions contre les
Talibans, car ces derniers le protègent.
De plus, dans son discours de réaction aux attentats, George
Bush ne désigne pas un pays responsable mais simplement « les ennemis de la liberté » et il
annonce alors une « guerre contre le terrorisme ».
Ainsi cette guerre est complètement abstraite car
le terrorisme est un concept.
Son discours renforce aussi l’idée de guerre asymétrique car il parle
d’une guerre « du monde entier », d’« une lutte de civilisation » ce qui montre un déséquilibre
complet des forces.
Pourtant, comme nous rappelle l’article du Moyen-Orient « l’EI s’étendait sur
environ 135 000 km² entre la Syrie et l’Irak, et avait été rejoint par quelques 40 000 combattants »,
un nombre qui semble conséquent mais en réalité ridicule face aux forces alliées.
Malgré cela, la
communauté internationale crée une perception de menace immédiate et justifie ainsi une
mobilisation mondiale.
C’est alors que nous pouvons voir un déséquilibre complet dans les forces
engagées des deux cotés du conflit.
Si la guerre est devenue multi-acteurs et asymétrique, c’est aussi par l’implication directe de
toutes les nations dans ce conflit contre le terrorisme, soit comme nation attaquée, soit comme alliée
d’une nation attaquée.
La menace des groupes comme Al-Qaïda et Daech est telle que toutes les
alliances sont mises en jeu.
La résolution de l’ONU montre bien que la communauté internationale
entière s’est mobilisée pour demander l’arrestation d’un homme et des sanctions sur un pays après
une attaque qui théoriquement ne concernait qu’un seul pays.
Le discours de Bush montre aussi que
les États-Unis veulent que tous leurs alliés les aident à se venger.
Il dit que « Chaque pays, dans
chaque région doit maintenant prendre une décision.
Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes
avec les terroristes ».
Cette affirmation forte montre bien l’implication forcée du monde entier dans
le conflit contre Al-Qaïda.
Mais si cette mobilisation est aussi générale c’est aussi parce que les
groupes terroristes ne limitent pas leurs attaques à un ou deux pays.
Les attentats ont lieu partout en
Europe, en Amérique du nord, au Moyen-Orient, en Afrique.
Leur pouvoir de déstabilisation est tel
que tous les pays s’impliquent dans le conflit.
Ce fut similaire dans le combat international contre
Daech.
Lorsque le groupe déclara l’avènement de son État Islamique, c’est une véritable guerre qui
fut menée avec des alliances très improbables qui se formèrent pour venir à bout de la menace.
L’article « Le Moyen-Orient en 2019 » parle de « coalition et des armées locales [en Syrie et en
Irak] ».
Ainsi la guerre est devenue mondiale en impliquant chaque pays dans le monde par le biais
d’alliances, d’attaques et d’organisations internationales, que le pays le veuille ou non.
Par cette guerre multi-acteurs et asymétrique, il devient naturel que les moyens engagés pour
venir à bout de la menace soient au-delà de tout ce qui a été jamais vu auparavant.
Les pays de
l’ouest, qui se veulent démocratiques, se sont toujours vantés d’être les protecteurs des droits de
l’homme.
Ainsi, ces pays, dont les États-Unis, doivent respecter les différents accords
internationaux, dont les droits de la guerre.
Mais comme les groupes terroristes ne respectent pas
ces droits, ciblent des civils et font des milliers de morts, tous les moyens sont engagés pour venir à
bout de ces attaquants.
George Bush montre bien cet engagement sans limite, presque une soif de
vengeance de la part des États-Unis, dans son discours post-11 septembre il dit clairement « nous
consacrerons toutes les ressources à notre disposition » dont « tous les instruments des forces de
l’ordre » et « toute arme nécessaire de guerre ».
Il affirme ici que son État ne s’arrêtera devant rien
pour parvenir à éliminer la menace.
Cet engagement face au terrorisme s’est révélé encore plus dans
le combat face à l’état islamique.
En effet, au vu de l’affront de Daech envers les frontières
internationalement reconnues et le patrimoine protégé, la coalition des états entrés en guerre contre
le groupe a engagé des moyens exceptionnels.
Des millions de dollars d’armes, d’équipements, de
soldats et autres matériels furent engagés pour combattre la menace.
Pour réussir à se battre contre le monde entier ligué contre eux, les groupes terroristes
s’appuient sur une idéologie extrême, jamais vue dans les groupes armées auparavant.
Leurs
attaques, qu’ils appellent « djihads », visent à restaurer l’islam « pur » de leur interprétation
extrémiste de la Charia.
Cet engagement idéologique est ce qui leur permet de mettre en place les
attentats car ceux-ci sont couvent des « attentats suicides » où les combattant du groupe se sacrifient
pour tuer le plus de personnes possibles avec lui.
Pendant les attentats du 11 septembre 2001 ce sont
11 terroristes de Al-Qaïda qui sont morts pour leur cause, guidés par leur idéologie.
Pour Daech, ce
sont plus de « 40000 combattants » qui se sont engagés de leur côté pour défendre le nouveau
califat.
La photo de Abou Bakr Al-Bagdadi montre à quel point la religion joue un rôle dans tous
leurs actes.
De plus le terme « djihadisme », qu’il soit international ou national, veut littéralement
dire qu’ils mènent des « djihads », ou des croisades musulmanes.
Ils pratiquent leurs attentats pour
essayer de punir ceux qui ont dévié de la foi pure et recrutent sur la base de croyances.
Ils sont
guidés par leur foi à un niveau si élevé que bien qu’il fut aperçu auparavant par exemple chez les
kamikazes japonais pendant la seconde guerre mondiale, il fut très rarement atteint.
Nous
remarquons alors l’importance extrême du facteur idéologique dans ce nouveau type de guerre.
Les
combattants se battent pour leur interprétation de la religion et ils sont prêts à tout pour leur cause.
Si la manière dont la guerre est menée....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les jours sont des fruits et notre rôle est de les manger, de les goûter doucement ou voracement selon notre nature propre, de profiter de tout ce qu'ils contiennent, d'en faire notre chair spirituelle et notre âme, de vivre. Vivre n'a donc pas d'autre sens que ça. Tout ce que nous propose la civilisation, tout ce qu'elle nous apporte, tout ce qu'elle nous apportera, n'est rien si nous ne comprenons pas qu'il est plus émouvant pour chacun de nous de vivre un jour que de réussir en avi
- Illustrer le jugement de Perrault à propos des contes : « ces bagatelle n'est pas de pure bagatelles que sa renferme une morale utile et que le récit enjoué dont elles sont enveloppées n'ont été choisies que pour les faire entrer dans l'esprit et d'une manière qui instruit et divertit tout ensemble ».
- L'apologue, petit récit à visée morale, est une forme d'argumentation indirecte dont le but est de faire passer un message. Quel est, selon vous, l'intérêt d'argumenter à l'aide de récits imagés plutôt que de manière directe ?
- Comment Hitler Monte Au Pouvoir Légalement A la fin de la première guerre mondiale, l’Allemagne humiliée par le traité de Versailles, doit faire face à plusieurs difficultés.
- La Guerre et la paixLéon TolstoïTroisième partie (extrait)Voulant faire le tour de la table, il se souleva mais la tante lui passa la tabatièredirectement, derrière le dos d'Hélène qui se pencha en avant pour faciliter le gestede la vieille dame et se retourna en souriant.