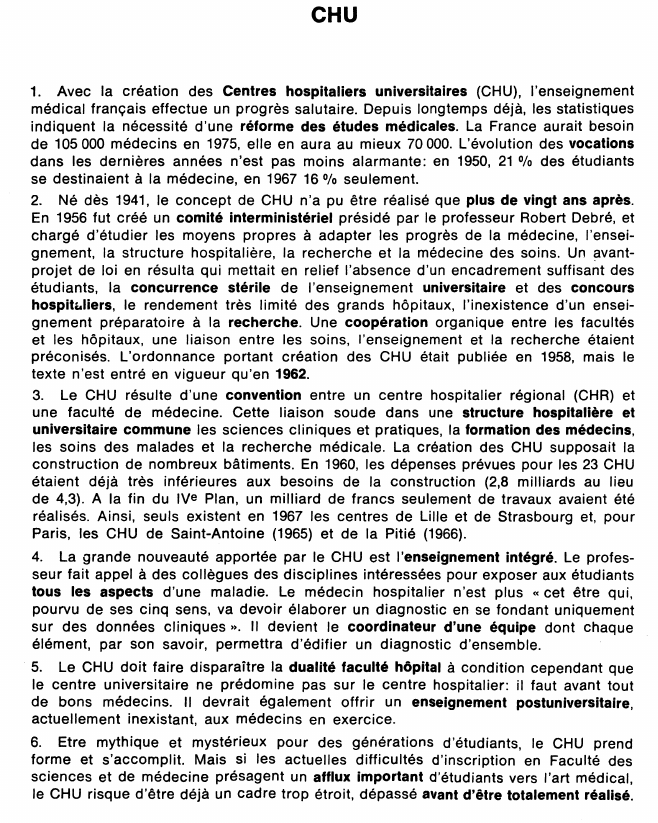CHU
Publié le 16/05/2020
Extrait du document
«
1 / 2 6 décembre 1967 Série D-6 Fiche N• 2116
CHU
1.
Avec la création des Centres hospitaliers universitaires (CHU), l'enseignement
médical français effectue un progrès salutaire.
Depuis longtemps déjà, les statistiques indiquent la nécessité d'une réforme des études médicales.
La France aurait besoin de 105 000 médecins en 1975, elle en aura au mieux 70 000.
L'évolution des vocations
dans les dernières années n'est pas moins alarmante: en 1950, 21 % des étudiants
se destinaient à la médecine, en 1967 16% seulement.
2.
Né dès 1941, le concept de CHU n'a pu être réalisé que plus de vingt ans après.
En 1956 fut créé un comité interministériel présidé par le professeur Robert Debré, et chargé d'étudier les moyens propres à adapter les progrès de la médecine, l'ensei
gnement, la structure hospitalière, la recherche et la médecine des soins.
Un avant projet de loi en résulta qui mettait en relief l'absence d'un encadrement suffisant des
étudiants, la concurrence stérile de l'enseignement universitaire et des concours
hospitc.liers, le rendement très limité des grands hôpitaux, l'inexistence d'un ensei gnement préparatoire à la recherche.
Une coopération organique entre les facultés
et les hôpitaux, une liaison entre les soins, l'enseignement et la recherche étaient
préconisés.
L'ordonnance portant création des CHU était publiée en 1958, mais le
texte n'est entré en vigueur qu'en 1962.
3.
Le CHU résulte d'une convention entre un centre hospitalier régional (CHR) et
une faculté de médecine.
Cette liaison soude dans une structure hospitalière et
universitaire commune les sciences cliniques et pratiques, la formation des médecins,
les soins des malades et la recherche médicale.
La création des CHU supposait la construction de nombreux bâtiments.
En 1960, les dépenses prévues pour les 23 CHU étaient déjà très inférieures aux besoins de la construction (2,8 milliards au lieu
de 4,3).
A la fin du IVe Plan, un milliard de francs seulement de travaux avaient été
réalisés.
Ainsi, seuls existent en 1967 les centres de Lille et de Strasbourg et, pour Paris, les CHU de Saint-Antoine (1965) et de la Pitié (1966).
4.
La grande nouveauté apportée par le CHU est l'enseignement intégré.
Le profes
seur fait appel à des collègues des disciplines intéressées pour exposer aux étudiants
tous les aspects d'une maladie.
Le médecin hospitalier n'est plus "cet être qui,
pourvu de ses cinq sens, va devoir élaborer un diagnostic en se fondant uniquement sur des données cliniques "· Il devient le coordinateur d'une équipe dont chaque
élément, par son savoir, permettra d'édifier un diagnostic d'ensemble.
5.
Le CHU doit faire disparaître la dualité faculté hôpital à condition cependant que
le centre universitaire ne prédomine pas sur le centre hospitalier: il faut avant tout de bons médecins.
Il devrait également offrir un enseignement postuniversitaire,
actuellement inexistant, aux médecins en exercice.
6.
Etre mythique et mystérieux pour des générations d'étudiants, le CHU prend
forme et s'accomplit.
Mais si les actuelles difficultés d'inscription en Faculté des sciences et de médecine présagent un afflux important d'étudiants vers l'art médical,
le CHU risque d'être déjà un cadre trop étroit, dépassé avant d'être totalement réalisé.
l
~
1
j
~
1
l
' 1
2 / 2.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓