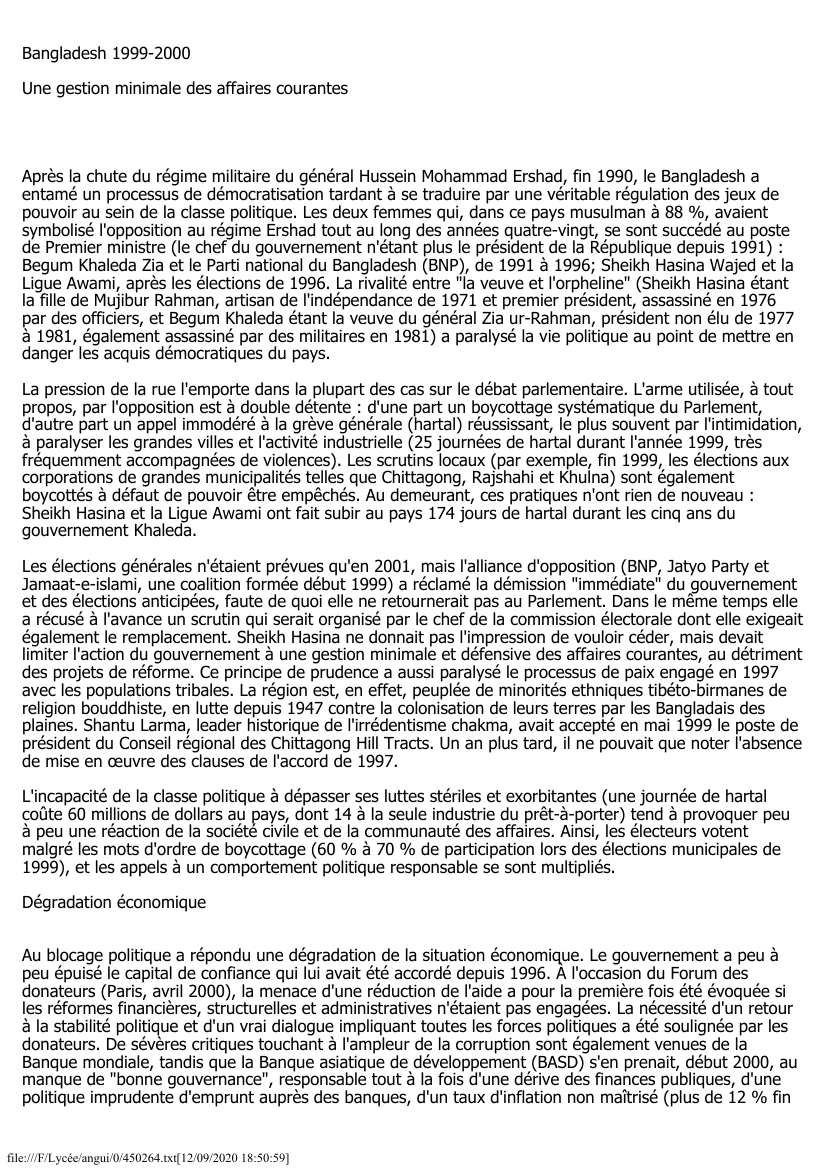Bangladesh 1999-2000 Une gestion minimale des affaires courantes
Publié le 12/09/2020
Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Bangladesh 1999-2000 Une gestion minimale des affaires courantes. Ce document contient 743 mots soit 2 pages. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format PDF sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en: Histoire-géographie.
«
file:///F/Lycée/angui/0/450264.txt[12/09/2020 18:50:59]
Bangladesh 1999-2000
Une gestion minimale des affaires courantes
Après la chute du régime militaire du général Hussein Mohamm
ad Ershad, fin 1990, le Bangladesh a
entamé un processus de démocratisation tardant à se traduire pa
r une véritable régulation des jeux de
pouvoir au sein de la classe politique.
Les deux femmes qui, dans ce pay
s musulman à 88 %, avaient
symbolisé l'opposition au régime Ershad tout au long des années
quatre-vingt, se sont succédé au poste
de Premier ministre (le chef du gouvernement n'étant plus le prés
ident de la République depuis 1991) :
Begum Khaleda Zia et le Parti national du Bangladesh (BNP), de 1991 à
1996; Sheikh Hasina Wajed et la
Ligue Awami, après les élections de 1996.
La rivalité entre "la
veuve et l'orpheline" (Sheikh Hasina étant
la fille de Mujibur Rahman, artisan de l'indépendance de 1971 et prem
ier président, assassiné en 1976
par des officiers, et Begum Khaleda étant la veuve du général Z
ia ur-Rahman, président non élu de 1977
à 1981, également assassiné par des militaires en 1981) a para
lysé la vie politique au point de mettre en
danger les acquis démocratiques du pays.
La pression de la rue l'emporte dans la plupart des cas sur le débat
parlementaire.
L'arme utilisée, à tout
propos, par l'opposition est à double détente : d'une part un boyc
ottage systématique du Parlement,
d'autre part un appel immodéré à la grève générale (h
artal) réussissant, le plus souvent par l'intimidation,
à paralyser les grandes villes et l'activité industrielle (25 jou
rnées de hartal durant l'année 1999, très
fréquemment accompagnées de violences).
Les scrutins locaux (par
exemple, fin 1999, les élections aux
corporations de grandes municipalités telles que Chittagong, Rajshahi
et Khulna) sont également
boycottés à défaut de pouvoir être empêchés.
Au demeur
ant, ces pratiques n'ont rien de nouveau :
Sheikh Hasina et la Ligue Awami ont fait subir au pays 174 jours de hart
al durant les cinq ans du
gouvernement Khaleda.
Les élections générales n'étaient prévues qu'en 2001, mai
s l'alliance d'opposition (BNP, Jatyo Party et
Jamaat-e-islami, une coalition formée début 1999) a réclamé
la démission "immédiate" du gouvernement
et des élections anticipées, faute de quoi elle ne retournerait pa
s au Parlement.
Dans le même temps elle
a récusé à l'avance un scrutin qui serait organisé par le ch
ef de la commission électorale dont elle exigeait
également le remplacement.
Sheikh Hasina ne donnait pas l'impression
de vouloir céder, mais devait
limiter l'action du gouvernement à une gestion minimale et défensi
ve des affaires courantes, au détriment
des projets de réforme.
Ce principe de prudence a aussi paralysé l
e processus de paix engagé en 1997
avec les populations tribales.
La région est, en effet, peuplée de
minorités ethniques tibéto-birmanes de
religion bouddhiste, en lutte depuis 1947 contre la colonisation de leur
s terres par les Bangladais des
plaines.
Shantu Larma, leader historique de l'irrédentisme chakma, av
ait accepté en mai 1999 le poste de
président du Conseil régional des Chittagong Hill Tracts.
Un an pl
us tard, il ne pouvait que noter l'absence
de mise en œuvre des clauses de l'accord de 1997.
L'incapacité de la classe politique à dépasser ses luttes sté
riles et exorbitantes (une journée de hartal
coûte 60 millions de dollars au pays, dont 14 à la seule industrie
du prêt-à-porter) tend à provoquer peu
à peu une réaction de la société civile et de la communauté
des affaires.
Ainsi, les électeurs votent
malgré les mots d'ordre de boycottage (60 % à 70 % de participati
on lors des élections municipales de
1999), et les appels à un comportement politique responsable se sont
multipliés.
Dégradation économique
Au blocage politique a répondu une dégradation de la situation é
conomique.
Le gouvernement a peu à
peu épuisé le capital de confiance qui lui avait été accordé
depuis 1996.
À l'occasion du Forum des
donateurs (Paris, avril 2000), la menace d'une réduction de l'aide
a pour la première fois été évoquée si
les réformes financières, structurelles et administratives n'ét
aient pas engagées.
La nécessité d'un retour
à la stabilité politique et d'un vrai dialogue impliquant toutes l
es forces politiques a été soulignée par les
donateurs.
De sévères critiques touchant à l'ampleur de la corr
uption sont également venues de la
Banque mondiale, tandis que la Banque asiatique de développement (BA
SD) s'en prenait, début 2000, au
manque de "bonne gouvernance", responsable tout à la fois d'une dé
rive des finances publiques, d'une
politique imprudente d'emprunt auprès des banques, d'un taux d'inflat
ion non maîtrisé (plus de 12 % fin.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Vanuatu (1999-2000)
- Turquie (1999-2000): Séisme meurtrier
- Turquie (1999-2000) Séisme meurtrier
- République tchèque (1999-2000): Éveil d'initiatives civiques
- Tanzanie (1999-2000): Manœuvres préélectorales