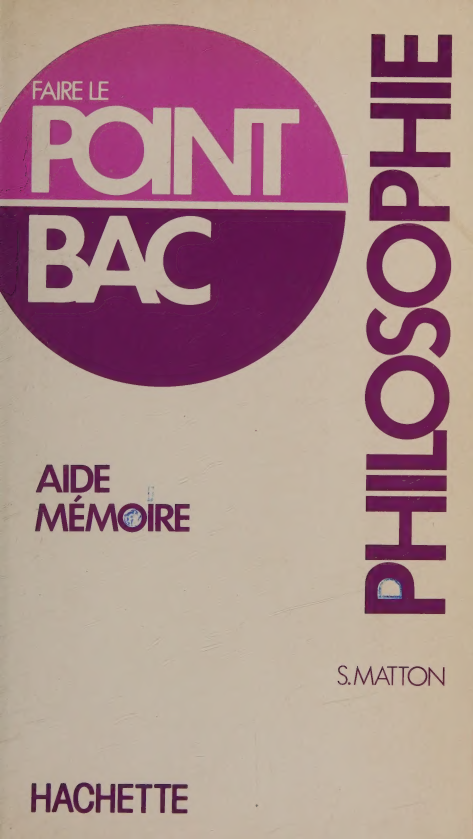Bac philosophie
Publié le 26/01/2025
Extrait du document
«
=
a
AIDE |
~ MEMOIRE
HACHETTE
»PHI
a
FAIRE LE POINT BAC
4
the
eas Sd
ea
WY)
AIDE
MEMOIRE
O
+
a.
S.MATTON
HACHETTE
avant-propos
ge
t
ésja
Les ouvrages de cette collection ont pour but d’aider les étudiants a préparer
leur baccalauréat de facon intensive et efficace.
@ Ce volume « Aide-mémoire » ne vise ni a se substituer au travail fait en
classe, ni méme a remplacer un manuel, mais simplement a rappeler, pour
chacun des themes du programme, un certain nombre de points importants
sur lesquels |’éléve pourra appuyer sa réflexion.
Ces éléments de réflexion ont été choisis en fonction des problématiques
qui reviennent le plus frequemment dans les sujets proposés au baccalauréat ces cing derniéres années.
Tout en nous efforcant d’étre le plus concis possible, nous avons veillé a
rester toujours suffisamment explicite.
Afin de ne pas surcharger la mémoire
de |'éléve, nous avons délibérément choisi de nous référer essentiellement 4
des auteurs inscrits au programme, dont certaines theses fondamentales
sont, lorsque cela est nécessaire, expliquées a part et en détail.
Nous avons
donné en appendice de bréves notices bio-bibliographiques sur ces auteurs,
ainsi qu'un lexique des termes philosophiques utilisés.
@ Le volume « Sujets commentés » propose une méthode de rédaction
et des conseils pratiques illustrés par des corrigés, mais surtout par des
devoirs réels d'éléves, qui y sont analysés et critiqués.
ISBN
2-01-008241-9
© HACHETTE 1983
79, Boulevard St-Germain F 75006 PARIS
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41 d'une part, que
les « copies ou reproductions strictement réservées a |'usage privé du copiste et non destinées
a une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but
d'exemple et diillustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite
sans le consentement de |’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1°°
de I’article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une
contrefacon par les articles 425 et suivants du Code pénal.
Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
1 la conscience
séries A, B, C, D, E.
$
1| approche générale
@ Laconscience est I'intuition (c’est-a-dire la connaissance immédiate) qu’a
un sujet de son activité psychique, de ses actes, du monde et de lui-méme.
@ || convient de ne pas confondre la conscience ainsi définie avec la
conscience morale, c'est-a-dire la propriété que posséderait l'esprit humain
de porter spontanément des jugements de valeur morale (cf.
« la voix de la
conscience »).
@ || n'est pas possible d’assimiler, comme le fit la psychologie classique, la
conscience au psychisme deés lors qu'il existe des faits psychiques inconscients.
2 |conscience spontanée et conscience réfléchie
— laconscience spontanée est celle qui accompagne tous les actes du sujet
et par laquelle ces actes sont simplement éprouvés, vécus ;
— la conscience réfléchie est celle dans laquelle le sujet se saisit lul-méme
comme conscience, c’est-a-dire est conscient d’étre conscient (cf.
« prendre
conscience de qq ch.
»).
Cette conscience est donc distincte de ce dont elle
est conscience.
@ Ces deux aspects ne sont naturellement pas opposés et la conscience
réfléchie est toujours latente dans la conscience spontanée.
3 |caractéres de la conscience
@ Selon I'analyse, devenue classique, de W.
James, la conscience se
caractérise par sa :
— mobilité : la conscience ne cesse de changer; des états de conscience
se suivent et s‘écoulent sans cesse et nul état, une fois disparu, ne peut se
reproduire de maniére identique.
Ce qui peut reparaitre plusieurs fois c'est
l'objet, jamais la maniére dont la conscience a, 4 un moment donné, saisi cet
objet;
— continuité : il n'y a pas de « cassures » dans la conscience, mais
chacun de ses états est solidaire de celui qui le précéde et les changements
qualitatifs dans son contenu ne sont jamais brusques;
[nnn
tO
4 L'HOMME
ET LE MONDE
F
5
la conscience
— sélection : la conscience ne s'intéresse pas de la méme maniére a tout
ce qui entre dans son champ : elle néglige certains éléments et en privilégie
d'autres (deux personnes ne verront pas dans un tableau les mémes choses).
4|la conscience comme activité de synthése
@ Comme |'a souligné P.
Janet, la principale fonction de la conscience est
‘adaptation au réel.
Cette « fonction du réel » suppose une activité de
synthése :
— synthése temporelle : la conscience n'est pas prise dans |'instant
présent, mais elle unifie le passé au présent et elle est tendue vers |'avenir;
— synthése perceptive : la conscience rassemble et organise les données
de la sensation ;
— synthese cognitive : la conscience rassemble savoirs et savoir-faire;
— synthése personnelle : la conscience unifie tous ses états en les
rapportant au moi.
5 |la conscience comme intentionnalité
@ Pour Husserl et la phénoménologie (cf.
Sartre, Merleau-Ponty), la
conscience ne peut se définir par son intériorité, mais par son rapport au
monde, car « toute conscience est conscience de quelque chose ».
On ne
peut donc penser la conscience si on lui retire son objet : parler de
conscience en soi est une absurdité.
@ En outre, la conscience n'est pas passive, mais elle est l'activité de
'esprit se tournant vers l'objet : percevoir une pomme ce n’est pas avoir
une pomme en miniature dans l'esprit, mais viser l'objet pomme lui-méme.
Ainsi elle peut se définir comme une intentionnalité, c'est-a-dire comme une
visée, une direction active vers un objet.
6 |rapport de la conscience et de la vie organique
@ Ce probléme rejoint celui des rapports du corps et de l’esprit, puisque Ion
a longtemps identifié la conscience avec la pensée.
|| s‘agit de savoir si la
conscience et le corps (qui apparaissent comme deux réalités différentes
puisque l'une est matérielle et l'autre pas) entretiennent des relations
causales (c’est-d-dire si le corps a une action sur la conscience et
inversement), et si oui, lesquelles.
LA CONSCIENCE
5
la conscience
© On peut distinguer quatre positions fondamentales :
1) Le dualisme (cf.
Descartes) : l'esprit et le corps sont radicalement
différents et distincts, mais unis de telle sorte qu’ils exercent I'un sur l'autre
une action réciproque réelle.
2) Le parallélisme (cf.
Leibniz) : l'esprit et le corps sont deux réalités
distinctes et il n’existe entre eux aucune relation d'interaction et de
causalité, mais uniquement un lien de correspondance : a chaque état
psychique correspond un état organique sans que |’un soit la cause de I'autre.
3) Le monisme (cf.
Spinoza) : I’esprit et le corps ne constituent qu'une
unique réalité ; ils sont les attributs d'une seule et méme substance en tant
qu'elle est concue soit sous |'attribut de |’étendue, soit sous celui de la
pensée.
L'esprit et le corps répondent donc a une seule et méme connexion
de causes et ne peuvent avoir d'action l'un sur l'autre.
4) L'épiphénoménisme (cf.
Nietzsche) : le corps est la réalité fondamentale et le fait psychique se raméne au fait physiologique.
La conscience n‘est
qu'un reflet de /a réalité organique, un épiphénoméne, et ne peut donc avoir
une action sur cette derniére.
BERGSON : toute conscience est mémoire
Selon Bergson la mémoire est « coextensive a la conscience », cette derniére ne
pouvant a la limite qu’étre conscience du passé.
En effet toute perception, « si
instantanée soit-elle, consiste en une incalculable multitude d'éléments remémorés, et a vrai dire, toute perception est déja mémoire.
Nous ne percevons
pratiquement que le passé, le présent pur étant |'insaisissable progrés du passé
rongeant l'avenir ».
Mais il convient de distinguer deux états de conscience :
— la conscience attentive, qui est celle de |'action.
Elle se tourne vers le réel,
adhére a la situation présente en vue de réaliser une tache, une action qui se
prépare.
Pour cela, elle ferme la porte au passé (ou en un sens, crée le passé, car
celui « est cette partie de notre histoire qui n'intéresse pas notre action
présente ») pour nen retenir que ce qui peut étre utile a |'action présente;
— la conscience réveuse, en revanche, se détache du réel, s'en désintéresse,
tend vers ce que l'on nomme une « perte de conscience », au point de conduire
au sommeil.
Evoluant dans la durée, elle ne se ferme pas au passé mais coincidant
avec lui, devient pure mémoire.
C’est pourquoi « un étre humain qui réverait son
existence au lieu de la vivre tiendrait sans doute ainsi sous son regard, a tout
moment, la multitude infinie des détails de son histoire passée ».
6
L'HOMME
ET LE MONDE
|
¥ayy
2
Yinconscient
séries A, B, C, D, E.
1|I'inconscient avant Freud
@ En distinguant des niveaux de conscience, la psychologie classique
reconnait |'existence d'états et de comportements ot la conscience claire
est absente et qu'elle classe en :
1) inconscient primitif, regroupant l'ensemble des comportements héréditaires assurant les adaptations vitales élémentaires (actes réflexes et
instincts);
2) préconscient, incluant tout ce qui n'est pas saisi....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DE L'ANTHROPOLOGIE À LA PHILOSOPHIE (fiche bac)
- LA PHILOSOPHIE... UNE SCIENCE (fiche bac)
- Méthodologie de l'épreuve de philosophie au bac
- BAC BLANC TLCoefficientEAF écrit EAF oral Philosophie Littérature Histoire /
- La philosophie au bac