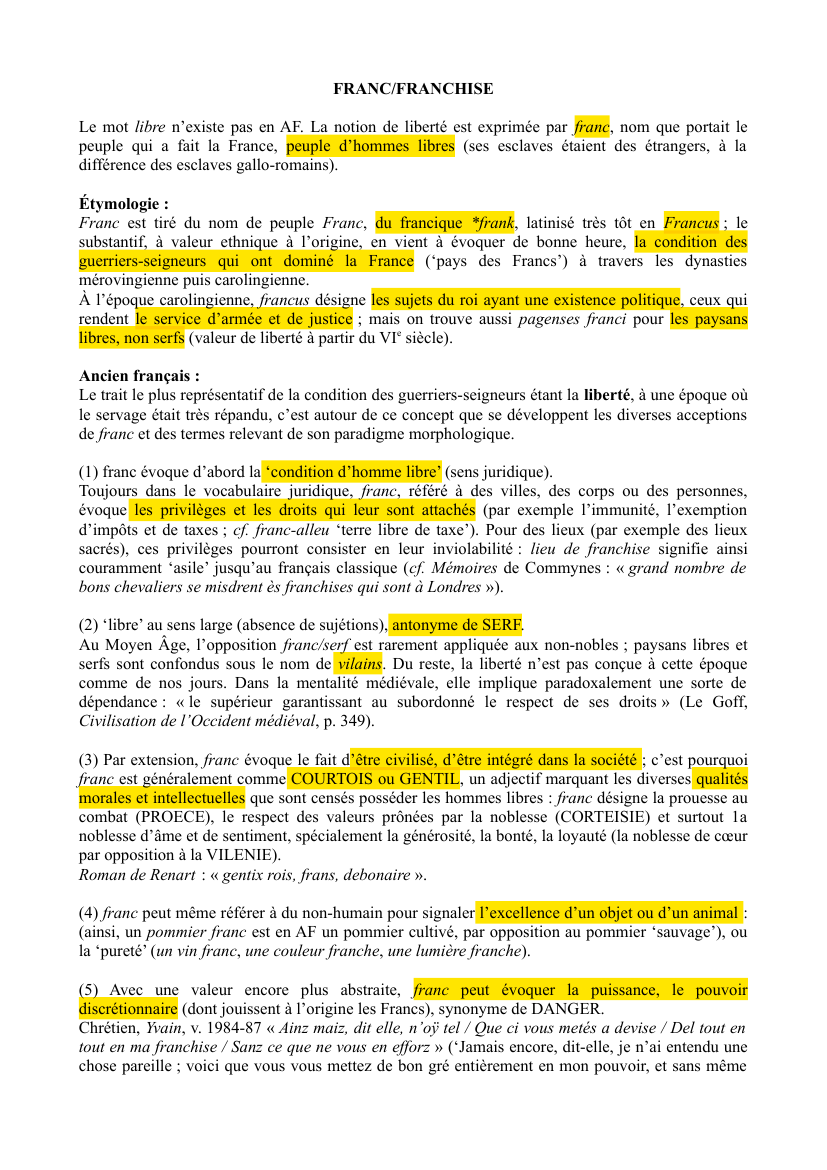Ancien français: FRANC/FRANCHISE
Publié le 20/01/2022
Extrait du document
«
FRANC/FRANCHISE
Le mot libre n’existe pas en AF.
La notion de liberté est exprimée par franc , nom que portait le
peuple qui a fait la France, peuple d’hommes libres (ses esclaves étaient des étrangers, à la
différence des esclaves gallo-romains).
Étymologie :
Franc est tiré du nom de peuple Franc , du francique *frank , latinisé très tôt en Francus ; le
substantif, à valeur ethnique à l’origine, en vient à évoquer de bonne heure, la condition des
guerriers-seigneurs qui ont dominé la France (‘pays des Francs’) à travers les dynasties
mérovingienne puis carolingienne.
À l’époque carolingienne, francus désigne les sujets du roi ayant une existence politique, ceux qui
rendent le service d’armée et de justice ; mais on trouve aussi pagenses franci pour les paysans
libres, non serfs (valeur de liberté à partir du VI e
siècle).
Ancien français :
Le trait le plus représentatif de la condition des guerriers-seigneurs étant la liberté , à une époque où
le servage était très répandu, c’est autour de ce concept que se développent les diverses acceptions
de franc et des termes relevant de son paradigme morphologique.
(1) franc évoque d’abord la ‘condition d’homme libre’ (sens juridique).
Toujours dans le vocabulaire juridique, franc , référé à des villes, des corps ou des personnes,
évoque les privilèges et les droits qui leur sont attachés (par exemple l’immunité, l’exemption
d’impôts et de taxes ; cf.
franc-alleu ‘terre libre de taxe’).
Pour des lieux (par exemple des lieux
sacrés), ces privilèges pourront consister en leur inviolabilité : lieu de franchise signifie ainsi
couramment ‘asile’ jusqu’au français classique ( cf.
Mémoires de Commynes : « grand nombre de
bons chevaliers se misdrent ès franchises qui sont à Londres »).
(2) ‘libre’ au sens large (absence de sujétions), antonyme de SERF.
Au Moyen Âge, l’opposition franc/serf est rarement appliquée aux non-nobles ; paysans libres et
serfs sont confondus sous le nom de vilains .
Du reste, la liberté n’est pas conçue à cette époque
comme de nos jours.
Dans la mentalité médiévale, elle implique paradoxalement une sorte de
dépendance : « le supérieur garantissant au subordonné le respect de ses droits » (Le Goff,
Civilisation de l’Occident médiéval , p.
349).
(3) Par extension, franc évoque le fait d’être civilisé, d’être intégré dans la société ; c’est pourquoi
franc est généralement comme COURTOIS ou GENTIL , un adjectif marquant les diverses qualités
morales et intellectuelles que sont censés posséder les hommes libres : franc désigne la prouesse au
combat (PROECE), le respect des valeurs prônées par la noblesse (CORTEISIE) et surtout 1a
noblesse d’âme et de sentiment, spécialement la générosité, la bonté, la loyauté (la noblesse de cœur
par opposition à la VILENIE).
Roman de Renart : « gentix rois, frans, debonaire ».
(4) franc peut même référer à du non-humain pour signaler l’excellence d’un objet ou d’un animal :
(ainsi, un pommier franc est en AF un pommier cultivé, par opposition au pommier ‘sauvage’), ou
la ‘pureté’ ( un vin franc , une couleur franche , une lumière franche ).
(5) Avec une valeur encore plus abstraite, franc peut évoquer la puissance, le pouvoir
discrétionnaire (dont jouissent à l’origine les Francs), synonyme de DANGER.
Chrétien, Yvain , v.
1984-87 « Ainz maiz, dit elle, n’oÿ tel / Que ci vous metés a devise / Del tout en
tout en ma franchise / Sanz ce que ne vous en efforz » (‘Jamais encore, dit-elle, je n’ai entendu une
chose pareille ; voici que vous vous mettez de bon gré entièrement en mon pouvoir, et sans même.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Après avoir écrit Lorenzaccio, Alfred de Musset adresse une lettre à son ancien ami Victor Hugo pour lui dire à quel point l'exposition de Hernani lui semble importante dans l'histoire du théâtre français. Rédigez cette lettre sans montrer de mépris pour le classicisme mais en utilisant l'exposition de Phèdre de Racine, de Tartuffe de Molière et de L'Ile aux esclaves de Marivaux.
- La ToussaintToussaint - (de l'ancien français Toz Sainz, " tous les Saints ") : depuisle IXe siècle, la Toussaint célèbre le 1er novembre la mémoire de tousles Saints, et anticipe dans la joie notre propre salut.
- Préparation à l’oral du baccalauréat de français Analyse linéaire n°4 - Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990 (épilogue)
- devoir 2 français cned La Leçon, d’Eugène Ionesco
- Vocabulaire français