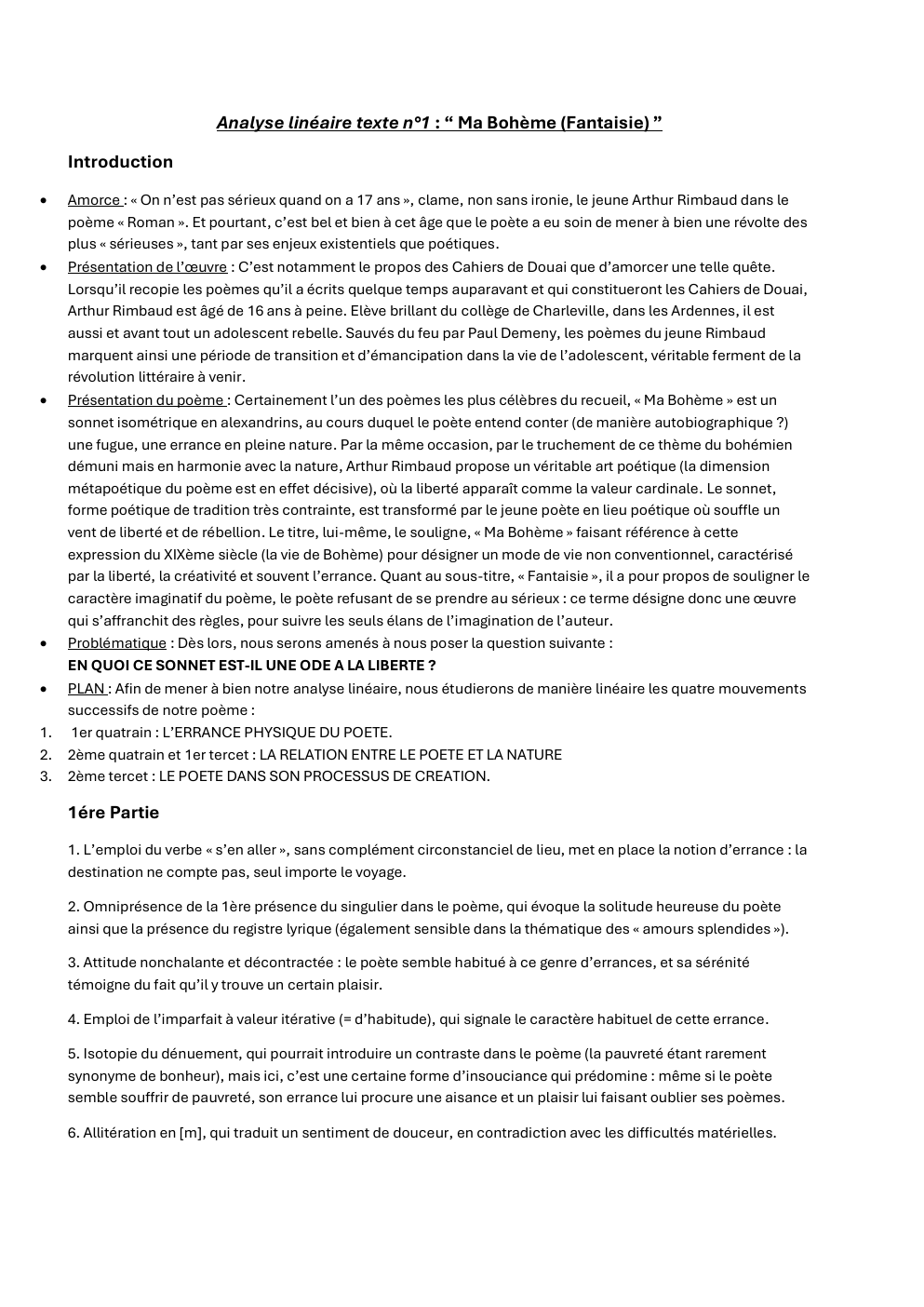analyse linéaire "Ma bohème (Fantasie)"
Publié le 29/03/2025
Extrait du document
«
Analyse linéaire texte n°1 : “ Ma Bohème (Fantaisie) ”
Introduction
•
Amorce : « On n’est pas sérieux quand on a 17 ans », clame, non sans ironie, le jeune Arthur Rimbaud dans le
poème « Roman ».
Et pourtant, c’est bel et bien à cet âge que le poète a eu soin de mener à bien une révolte des
plus « sérieuses », tant par ses enjeux existentiels que poétiques.
• Présentation de l’œuvre : C’est notamment le propos des Cahiers de Douai que d’amorcer une telle quête.
Lorsqu’il recopie les poèmes qu’il a écrits quelque temps auparavant et qui constitueront les Cahiers de Douai,
Arthur Rimbaud est âgé de 16 ans à peine.
Elève brillant du collège de Charleville, dans les Ardennes, il est
aussi et avant tout un adolescent rebelle.
Sauvés du feu par Paul Demeny, les poèmes du jeune Rimbaud
marquent ainsi une période de transition et d’émancipation dans la vie de l’adolescent, véritable ferment de la
révolution littéraire à venir.
• Présentation du poème : Certainement l’un des poèmes les plus célèbres du recueil, « Ma Bohème » est un
sonnet isométrique en alexandrins, au cours duquel le poète entend conter (de manière autobiographique ?)
une fugue, une errance en pleine nature.
Par la même occasion, par le truchement de ce thème du bohémien
démuni mais en harmonie avec la nature, Arthur Rimbaud propose un véritable art poétique (la dimension
métapoétique du poème est en effet décisive), où la liberté apparaît comme la valeur cardinale.
Le sonnet,
forme poétique de tradition très contrainte, est transformé par le jeune poète en lieu poétique où souffle un
vent de liberté et de rébellion.
Le titre, lui-même, le souligne, « Ma Bohème » faisant référence à cette
expression du XIXème siècle (la vie de Bohème) pour désigner un mode de vie non conventionnel, caractérisé
par la liberté, la créativité et souvent l’errance.
Quant au sous-titre, « Fantaisie », il a pour propos de souligner le
caractère imaginatif du poème, le poète refusant de se prendre au sérieux : ce terme désigne donc une œuvre
qui s’affranchit des règles, pour suivre les seuls élans de l’imagination de l’auteur.
• Problématique : Dès lors, nous serons amenés à nous poser la question suivante :
EN QUOI CE SONNET EST-IL UNE ODE A LA LIBERTE ?
• PLAN : Afin de mener à bien notre analyse linéaire, nous étudierons de manière linéaire les quatre mouvements
successifs de notre poème :
1.
1er quatrain : L’ERRANCE PHYSIQUE DU POETE.
2.
2ème quatrain et 1er tercet : LA RELATION ENTRE LE POETE ET LA NATURE
3.
2ème tercet : LE POETE DANS SON PROCESSUS DE CREATION.
1ére Partie
1.
L’emploi du verbe « s’en aller », sans complément circonstanciel de lieu, met en place la notion d’errance : la
destination ne compte pas, seul importe le voyage.
2.
Omniprésence de la 1ère présence du singulier dans le poème, qui évoque la solitude heureuse du poète
ainsi que la présence du registre lyrique (également sensible dans la thématique des « amours splendides »).
3.
Attitude nonchalante et décontractée : le poète semble habitué à ce genre d’errances, et sa sérénité
témoigne du fait qu’il y trouve un certain plaisir.
4.
Emploi de l’imparfait à valeur itérative (= d’habitude), qui signale le caractère habituel de cette errance.
5.
Isotopie du dénuement, qui pourrait introduire un contraste dans le poème (la pauvreté étant rarement
synonyme de bonheur), mais ici, c’est une certaine forme d’insouciance qui prédomine : même si le poète
semble souffrir de pauvreté, son errance lui procure une aisance et un plaisir lui faisant oublier ses poèmes.
6.
Allitération en [m], qui traduit un sentiment de douceur, en contradiction avec les difficultés matérielles.
7.
Complément circonstanciel de lieu, qui situe l’errance en pleine nature.
L’imprécision de cette localisation
ne manquera pas de frapper le lecteur.
Cela confirme que, pour le poète, la destination n’a pas d’importance
tant qu’il peut rester en extérieur, c’est-à-dire proche de la nature.
8.
Apostrophe de la Muse + Relation d’autorité que la Muse exerce sur le poète : Le poète interpelle la Muse,
allégorie de l’inspiration poétique, en la tutoyant, ce qui est original, la Muse étant d’habitude une figure très
respectée par les poètes.
Cette forme d’impertinence illustre parfaitement la rébellion du jeune Rimbaud, mais
aussi la relation privilégiée qu’il entretient avec la poésie (il se présente comme son « féal », c’est-à-dire son
fidèle serviteur).
2EME PARTIE (2EME QUATRAIN ET 1ER TERCET) : LA RELATION ENTRE LE POETE ET LA NATURE
9.
Ponctuation expressive et interjections enfantines, qui traduisent une forme d’allégresse, de fougue, de
bonheur, mais aussi une certaine forme d’autodérision à son égard, le poète refusant de se prendre trop au
sérieux.
10.
Rime entre « crevées » et « rêvées », qui peut nous faire comprendre que le pouvoir de l’imagination permet
de contrecarrer les contraintes matérielles : les « poches crevées » sont ici remplacées par des « amours
splendides [rêvées] ».
2éme Partie
1.
Isotopie du dénuement, qui traduit de nouveau une certaine forme d’insouciance : même si le poète semble
souffrir de pauvreté, son errance lui procure une aisance et un plaisir lui faisant oublier ses poèmes.
2.
Métaphore au moyen de laquelle le poète s’associe au « Petit-Poucet », qui poursuit la thématique de
l’errance ainsi que celle de la pauvreté et du dénuement (pour mémoire, dans le conte, le Petit-Poucet est issu
d’une famille pauvre), tout en introduisant l’idée que la poésie est son guide.
En effet, le Petit-Poucet sème des
miettes pour retrouver son chemin ; ici, le poète sème des « rimes ».
En somme, comme le Petit-Poucet,
Rimbaud aurait fui sa famille, mais il laisse derrière lui quelque chose de plus durable et substantiel que des
miettes de pain : de la poésie.
3.
Rimbaud sur l’importance de la poésie via le mot rime, en le plaçant au centre du poème (7ème vers sur 14)
et en le rejetant grâce à un procédé d’enjambement.
4.
L’emploi du substantif « ma course » introduit un crescendo par rapport au verbe « s’en aller » de la strophe 1
: le mouvement se fait plus rapide, comme sous l’effet de l’euphorie et de l’allégresse.
5.
Métaphore indiquant que le poète dort à la belle étoile, ce qui renforce le sentiment de liberté et l’idée de
dénuement, de pauvreté.
Notons que la nature est une « auberge » pour le poète, ce qui fait d’elle une hôtesse
agréable et prévenante.
6.
Emploi d’un déterminant possessif, indiquant le poète s’approprie la nature.
Le fait de dormir dehors, loin
d’engendrer de la souffrance, lui permet de créer une harmonie avec la nature et donc de trouver l’inspiration
poétique.
7.
Sollicitation de plusieurs sens, qui témoigne d’une appropriation personnelle....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse linéaire "Ma Bohème"
- Préparation à l’oral du baccalauréat de français Analyse linéaire n°4 - Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990 (épilogue)
- Objet d'étude : La poésie du XIX et du XX siècle. Parcours complémentaire : Alchimie poétique : réinventer le monde. Analyse linéaire 2/2 « Le Pain », Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942
- analyse linéaire les complaintes du pauvre jeune homme de Jules Laforgue
- Une Charogne, Baudelaire : analyse linéaire