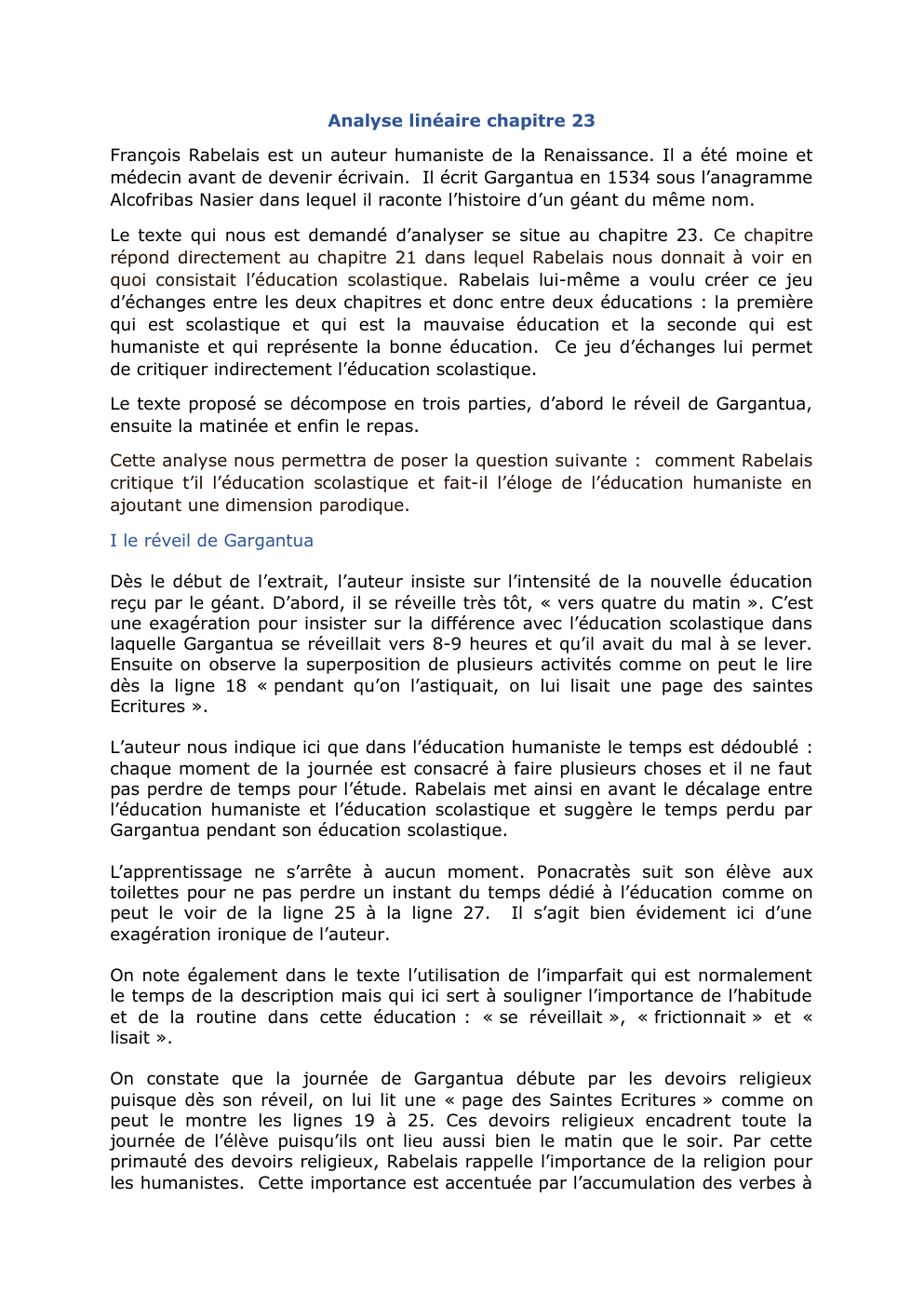analyse linéaire chapitre 23 gargantua
Publié le 06/02/2025
Extrait du document
«
Analyse linéaire chapitre 23
François Rabelais est un auteur humaniste de la Renaissance.
Il a été moine et
médecin avant de devenir écrivain.
Il écrit Gargantua en 1534 sous l’anagramme
Alcofribas Nasier dans lequel il raconte l’histoire d’un géant du même nom.
Le texte qui nous est demandé d’analyser se situe au chapitre 23.
Ce chapitre
répond directement au chapitre 21 dans lequel Rabelais nous donnait à voir en
quoi consistait l’éducation scolastique.
Rabelais lui-même a voulu créer ce jeu
d’échanges entre les deux chapitres et donc entre deux éducations : la première
qui est scolastique et qui est la mauvaise éducation et la seconde qui est
humaniste et qui représente la bonne éducation.
Ce jeu d’échanges lui permet
de critiquer indirectement l’éducation scolastique.
Le texte proposé se décompose en trois parties, d’abord le réveil de Gargantua,
ensuite la matinée et enfin le repas.
Cette analyse nous permettra de poser la question suivante : comment Rabelais
critique t’il l’éducation scolastique et fait-il l’éloge de l’éducation humaniste en
ajoutant une dimension parodique.
I le réveil de Gargantua
Dès le début de l’extrait, l’auteur insiste sur l’intensité de la nouvelle éducation
reçu par le géant.
D’abord, il se réveille très tôt, « vers quatre du matin ».
C’est
une exagération pour insister sur la différence avec l’éducation scolastique dans
laquelle Gargantua se réveillait vers 8-9 heures et qu’il avait du mal à se lever.
Ensuite on observe la superposition de plusieurs activités comme on peut le lire
dès la ligne 18 « pendant qu’on l’astiquait, on lui lisait une page des saintes
Ecritures ».
L’auteur nous indique ici que dans l’éducation humaniste le temps est dédoublé :
chaque moment de la journée est consacré à faire plusieurs choses et il ne faut
pas perdre de temps pour l’étude.
Rabelais met ainsi en avant le décalage entre
l’éducation humaniste et l’éducation scolastique et suggère le temps perdu par
Gargantua pendant son éducation scolastique.
L’apprentissage ne s’arrête à aucun moment.
Ponacratès suit son élève aux
toilettes pour ne pas perdre un instant du temps dédié à l’éducation comme on
peut le voir de la ligne 25 à la ligne 27.
Il s’agit bien évidement ici d’une
exagération ironique de l’auteur.
On note également dans le texte l’utilisation de l’imparfait qui est normalement
le temps de la description mais qui ici sert à souligner l’importance de l’habitude
et de la routine dans cette éducation : « se réveillait », « frictionnait » et «
lisait ».
On constate que la journée de Gargantua débute par les devoirs religieux
puisque dès son réveil, on lui lit une « page des Saintes Ecritures » comme on
peut le montre les lignes 19 à 25.
Ces devoirs religieux encadrent toute la
journée de l’élève puisqu’ils ont lieu aussi bien le matin que le soir.
Par cette
primauté des devoirs religieux, Rabelais rappelle l’importance de la religion pour
les humanistes.
Cette importance est accentuée par l’accumulation des verbes à
l’infinitif « révérer, adorer, prier et supplier » (ligne 20) qui donne un effet
d’insistance.
On observe également l’importance de la lecture dans l’éducation de Gargantua.
La lecture d’une seule page doit permettre à Gargantua une totale
compréhension de son contenu.
Elle doit être de qualité et soignée.
C’est pour
cela qu’elle est confiée à un valet dont c’est la mission principale et dont le nom
grec, Anagnostes, signifie justement « le lecteur ».
Par ailleurs, la lecture à voix
haute, la récitation, montrent que l’éducation humaniste repose également sur la
parole : "haute et intelligible voix" et "diction claire" (ligne .20), "son précepteur
répétait (ligne 26).
II La matinée
La matinée commence par l’observation des étoiles (ligne 25).
Rabelais rappelle
ici que l’enseignement humaniste est un enseignement fondé sur l’observation du
monde réel.
Ce n’est pas un enseignement livresque.
On retrouve l’importance
de la parole et de l’échange caractéristique de l’éducation humaniste.
L’utilisation de la troisième personne du pluriel « ils » dans la suite du texte
permet également de gommer la présence du maître et souligne que qu’ils sont
associés dans les apprentissages et qu’ils sont tous les deux sont placés sur un
pied d’égalité.
On remarque ainsi que Ponacratès est complétement absent de ce texte.
Il est
effacé.
Il est par exemple désigné par le pronom indéfini « on » à la ligne ligne
32 « on lui répétait les leçons de la veille »
C’est Gargantua qui est le sujet des verbes d’action comme en témoigne la ligne
« lui-même récitait » « et en tirait les exemples pratiques ».
Ici c’est l’élève qui
est important.
Rabelais met en évidence que l’apprentissage humaniste n’est
pas passif.
Ce n’est pas une simple transmission du savoir du maître à l’élève.
L’élève s’approprie le savoir et le met en pratique.
On retrouve également ici
l’idée de l’apprentissage par cœur typique de l’école scolastique.
Rabelais ne le
remet pas en cause mais il en critique l’utilisation qui en était fait.
Ce qui
différence les deux enseignements c’est la mise en pratique des apprentissages
par l’élève.
L’indication temporelle « Cela fait » permet à Rabelais d’insister sur les étapes
logiques de l’éducation du géant : à chaque paragraphe correspond une nouvelle
étape dans l’apprentissage.
La matinée est également consacrée aux soins corporels qui sont cités à deux
reprises aux lignes 31 et 44 .
Ainsi par l’énumération, à la ligne 31, des verbes «
habillé, peigné, coiffé, adorné et parfumé » permet à Rabelais de montrer, en
tant qu’ancien médecin, l’importance de l’hygiène corporelle dans cette nouvelle
éducation.
On retrouve également ici l’intensité de l’apprentissage avec le
dédoublement du temps et l’emploi de « pendant que » qui prouve que chaque
moment est consacré à l’apprentissage et qu’il n’y pas de perte de temps.
On retrouve également à ce moment de la journée l’importance de la lecture et
donc des livres.
C’est une référence voulu par l’auteur à l’invention de
l’imprimerie.
Le temps qui y est consacré « 3 heures » (ligne 35) est une
exagération mais elle sous-entend qu’il ne s’agit pas d’une simple lecture.
Elle
est toujours accompagnée d’une explication.
C’est un point de départ non
d’arrivé et est, toujours accompagnée d’une explication orale.
L’activité physique trouve également sa place dans cette éducation comme on
peut le voir aux ligne 41 et 42.
Le géant et son percepteur exercent leur « corps
aussi lestement qu’ils l’avaient fait auparavant de leur esprit ».
Dans l’éducation
humaniste, l’exercice du corps et de l’esprit esprit sont un ensemble.
Rabelais
s’inspire de Juvénal, un auteur de l’Antiquité, et du principe du « mens sana in
corpore sano » (un esprit sain dans un corps sain)
Le lexique du jeu est associé a celui de la liberté comme on peut le voir à la ligne
42 : « ils jouaient librement, abandonnant la partie quand ils voulaient ».
III Le repas
C’est ensuite le repas qui est décrit par Rabelais comme en témoigne la
personnification « Monsieur l’appétit » à la ligne 48.
Le repas décrit dans ce
chapitre s’oppose çà celui du chapitre 21.
L’énumération aux lignes 51 et 56 des aliments sains contraste avec la nourriture
grasse que Gargantua ingérait alors qu’il était éduqué par les scolastiques : « le
pain, le vin, l’eau, le sel, les viandes, les poissons, les fruits, les herbes, les
légumes ».
Ici le repas n’est pas l’occasion de la gourmandise.
Il permet au
corps de se nourrir, mais c’est d’abord un moment de convivialité et d’échanges :
ligne 52 à 53 : « ils commençaient à converser joyeusement ensemble ».
C’est
là encore une des différences avec l’éducation scolastique dans laquelle le repas
était uniquement l’occasion de se goinfrer.
Pendant le repas, l’instruction se poursuit car chaque aliment est accompagné
d’un commentaire, d’une explication sur ses « vertus », ses « propriétés
efficaces », et sa nature.
Gargantua observe ce qu’il mange et apprend
également de cette observation.
Conclusion
Ce chapitre ne peut se comprendre qu’en référence au chapitre 21 que le lecteur
vient de lire.
Dans la première édition les deux chapitres se suivaient.
Dans la
deuxième édition, Rabelais a intercalé un nouveau chapitre dans lesquelles se
trouve une liste de jeux dans auxquels joue Gargantua.
On y trouve une série
d’éléments qui caractérisent l’éducation humaniste : on observe le monde tout
autour, on apprend par cœur en y mettant le ton et donc pas bêtement, la
nourriture est saine et diététique et on prête attention à son hygiène corporelle.
On trouve également une série d’exagérations comme se lever à 4 heures du
matin, continuer la leçon aux toilettes, la lecture qui dure 3 heures.
C’est ici une
dimension parodique voulue par l’auteur.
On peut dire que c’est probablement le chapitre le plus sérieux du livre et si la
parodie existe elle reste discrète.
Ce caractère sérieux produit un effet de
contraste avec le chapitre 21.
La troisième partie du du texte débute par un adverbe de temps «
Cependant » suivit
d’une allégorie de « Monsieur l’Appétit » à la ligne 48.
C’est ensuite....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse Linéaire du chapitre XVII de Gargantua
- Le rouge et le noir chapitre 18 - Analyse linéaire
- explication linéaire gargantua chapitre 4
- analyse linéaire du prologue de Gargantua
- Analyse Linéaire Mme de Bovary: Extrait du chapitre VII, Première Partie