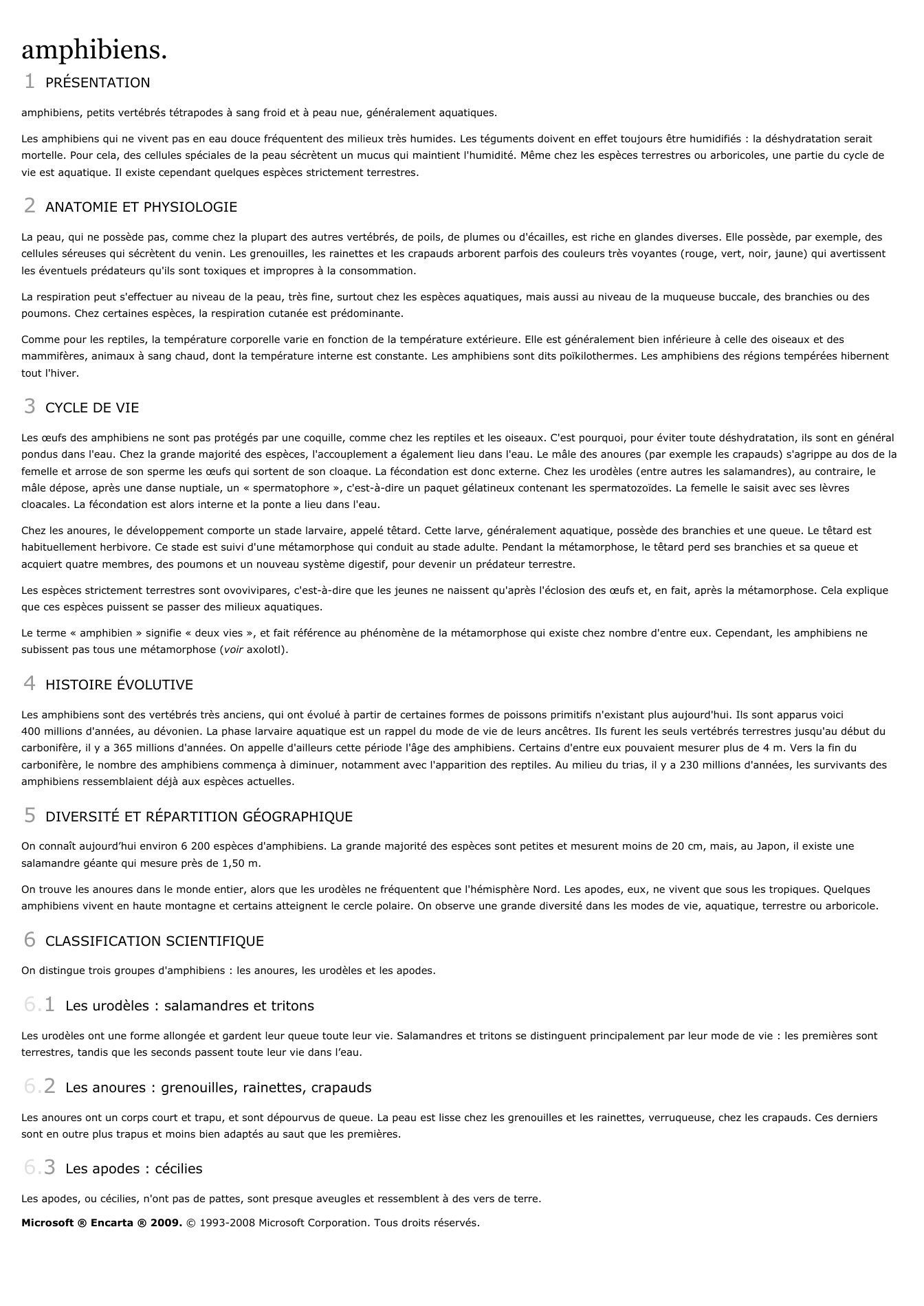amphibiens.
Publié le 06/12/2021
Extrait du document
Ci-dessous un extrait traitant le sujet : amphibiens.. Ce document contient 836 mots. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système d’échange gratuit de ressources numériques ou achetez-le pour la modique somme d’un euro symbolique. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en : Echange
amphibiens.
1
PRÉSENTATION
amphibiens, petits vertébrés tétrapodes à sang froid et à peau nue, généralement aquatiques.
Les amphibiens qui ne vivent pas en eau douce fréquentent des milieux très humides. Les téguments doivent en effet toujours être humidifiés : la déshydratation serait
mortelle. Pour cela, des cellules spéciales de la peau sécrètent un mucus qui maintient l'humidité. Même chez les espèces terrestres ou arboricoles, une partie du cycle de
vie est aquatique. Il existe cependant quelques espèces strictement terrestres.
2
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
La peau, qui ne possède pas, comme chez la plupart des autres vertébrés, de poils, de plumes ou d'écailles, est riche en glandes diverses. Elle possède, par exemple, des
cellules séreuses qui sécrètent du venin. Les grenouilles, les rainettes et les crapauds arborent parfois des couleurs très voyantes (rouge, vert, noir, jaune) qui avertissent
les éventuels prédateurs qu'ils sont toxiques et impropres à la consommation.
La respiration peut s'effectuer au niveau de la peau, très fine, surtout chez les espèces aquatiques, mais aussi au niveau de la muqueuse buccale, des branchies ou des
poumons. Chez certaines espèces, la respiration cutanée est prédominante.
Comme pour les reptiles, la température corporelle varie en fonction de la température extérieure. Elle est généralement bien inférieure à celle des oiseaux et des
mammifères, animaux à sang chaud, dont la température interne est constante. Les amphibiens sont dits poïkilothermes. Les amphibiens des régions tempérées hibernent
tout l'hiver.
3
CYCLE DE VIE
Les oeufs des amphibiens ne sont pas protégés par une coquille, comme chez les reptiles et les oiseaux. C'est pourquoi, pour éviter toute déshydratation, ils sont en général
pondus dans l'eau. Chez la grande majorité des espèces, l'accouplement a également lieu dans l'eau. Le mâle des anoures (par exemple les crapauds) s'agrippe au dos de la
femelle et arrose de son sperme les oeufs qui sortent de son cloaque. La fécondation est donc externe. Chez les urodèles (entre autres les salamandres), au contraire, le
mâle dépose, après une danse nuptiale, un « spermatophore «, c'est-à-dire un paquet gélatineux contenant les spermatozoïdes. La femelle le saisit avec ses lèvres
cloacales. La fécondation est alors interne et la ponte a lieu dans l'eau.
Chez les anoures, le développement comporte un stade larvaire, appelé têtard. Cette larve, généralement aquatique, possède des branchies et une queue. Le têtard est
habituellement herbivore. Ce stade est suivi d'une métamorphose qui conduit au stade adulte. Pendant la métamorphose, le têtard perd ses branchies et sa queue et
acquiert quatre membres, des poumons et un nouveau système digestif, pour devenir un prédateur terrestre.
Les espèces strictement terrestres sont ovovivipares, c'est-à-dire que les jeunes ne naissent qu'après l'éclosion des oeufs et, en fait, après la métamorphose. Cela explique
que ces espèces puissent se passer des milieux aquatiques.
Le terme « amphibien « signifie « deux vies «, et fait référence au phénomène de la métamorphose qui existe chez nombre d'entre eux. Cependant, les amphibiens ne
subissent pas tous une métamorphose (voir axolotl).
4
HISTOIRE ÉVOLUTIVE
Les amphibiens sont des vertébrés très anciens, qui ont évolué à partir de certaines formes de poissons primitifs n'existant plus aujourd'hui. Ils sont apparus voici
400 millions d'années, au dévonien. La phase larvaire aquatique est un rappel du mode de vie de leurs ancêtres. Ils furent les seuls vertébrés terrestres jusqu'au début du
carbonifère, il y a 365 millions d'années. On appelle d'ailleurs cette période l'âge des amphibiens. Certains d'entre eux pouvaient mesurer plus de 4 m. Vers la fin du
carbonifère, le nombre des amphibiens commença à diminuer, notamment avec l'apparition des reptiles. Au milieu du trias, il y a 230 millions d'années, les survivants des
amphibiens ressemblaient déjà aux espèces actuelles.
5
DIVERSITÉ ET RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
On connaît aujourd'hui environ 6 200 espèces d'amphibiens. La grande majorité des espèces sont petites et mesurent moins de 20 cm, mais, au Japon, il existe une
salamandre géante qui mesure près de 1,50 m.
On trouve les anoures dans le monde entier, alors que les urodèles ne fréquentent que l'hémisphère Nord. Les apodes, eux, ne vivent que sous les tropiques. Quelques
amphibiens vivent en haute montagne et certains atteignent le cercle polaire. On observe une grande diversité dans les modes de vie, aquatique, terrestre ou arboricole.
6
CLASSIFICATION SCIENTIFIQUE
On distingue trois groupes d'amphibiens : les anoures, les urodèles et les apodes.
6.1
Les urodèles : salamandres et tritons
Les urodèles ont une forme allongée et gardent leur queue toute leur vie. Salamandres et tritons se distinguent principalement par leur mode de vie : les premières sont
terrestres, tandis que les seconds passent toute leur vie dans l'eau.
6.2
Les anoures : grenouilles, rainettes, crapauds
Les anoures ont un corps court et trapu, et sont dépourvus de queue. La peau est lisse chez les grenouilles et les rainettes, verruqueuse, chez les crapauds. Ces derniers
sont en outre plus trapus et moins bien adaptés au saut que les premières.
6.3
Les apodes : cécilies
Les apodes, ou cécilies, n'ont pas de pattes, sont presque aveugles et ressemblent à des vers de terre.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
amphibiens.
1
PRÉSENTATION
amphibiens, petits vertébrés tétrapodes à sang froid et à peau nue, généralement aquatiques.
Les amphibiens qui ne vivent pas en eau douce fréquentent des milieux très humides. Les téguments doivent en effet toujours être humidifiés : la déshydratation serait
mortelle. Pour cela, des cellules spéciales de la peau sécrètent un mucus qui maintient l'humidité. Même chez les espèces terrestres ou arboricoles, une partie du cycle de
vie est aquatique. Il existe cependant quelques espèces strictement terrestres.
2
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
La peau, qui ne possède pas, comme chez la plupart des autres vertébrés, de poils, de plumes ou d'écailles, est riche en glandes diverses. Elle possède, par exemple, des
cellules séreuses qui sécrètent du venin. Les grenouilles, les rainettes et les crapauds arborent parfois des couleurs très voyantes (rouge, vert, noir, jaune) qui avertissent
les éventuels prédateurs qu'ils sont toxiques et impropres à la consommation.
La respiration peut s'effectuer au niveau de la peau, très fine, surtout chez les espèces aquatiques, mais aussi au niveau de la muqueuse buccale, des branchies ou des
poumons. Chez certaines espèces, la respiration cutanée est prédominante.
Comme pour les reptiles, la température corporelle varie en fonction de la température extérieure. Elle est généralement bien inférieure à celle des oiseaux et des
mammifères, animaux à sang chaud, dont la température interne est constante. Les amphibiens sont dits poïkilothermes. Les amphibiens des régions tempérées hibernent
tout l'hiver.
3
CYCLE DE VIE
Les oeufs des amphibiens ne sont pas protégés par une coquille, comme chez les reptiles et les oiseaux. C'est pourquoi, pour éviter toute déshydratation, ils sont en général
pondus dans l'eau. Chez la grande majorité des espèces, l'accouplement a également lieu dans l'eau. Le mâle des anoures (par exemple les crapauds) s'agrippe au dos de la
femelle et arrose de son sperme les oeufs qui sortent de son cloaque. La fécondation est donc externe. Chez les urodèles (entre autres les salamandres), au contraire, le
mâle dépose, après une danse nuptiale, un « spermatophore «, c'est-à-dire un paquet gélatineux contenant les spermatozoïdes. La femelle le saisit avec ses lèvres
cloacales. La fécondation est alors interne et la ponte a lieu dans l'eau.
Chez les anoures, le développement comporte un stade larvaire, appelé têtard. Cette larve, généralement aquatique, possède des branchies et une queue. Le têtard est
habituellement herbivore. Ce stade est suivi d'une métamorphose qui conduit au stade adulte. Pendant la métamorphose, le têtard perd ses branchies et sa queue et
acquiert quatre membres, des poumons et un nouveau système digestif, pour devenir un prédateur terrestre.
Les espèces strictement terrestres sont ovovivipares, c'est-à-dire que les jeunes ne naissent qu'après l'éclosion des oeufs et, en fait, après la métamorphose. Cela explique
que ces espèces puissent se passer des milieux aquatiques.
Le terme « amphibien « signifie « deux vies «, et fait référence au phénomène de la métamorphose qui existe chez nombre d'entre eux. Cependant, les amphibiens ne
subissent pas tous une métamorphose (voir axolotl).
4
HISTOIRE ÉVOLUTIVE
Les amphibiens sont des vertébrés très anciens, qui ont évolué à partir de certaines formes de poissons primitifs n'existant plus aujourd'hui. Ils sont apparus voici
400 millions d'années, au dévonien. La phase larvaire aquatique est un rappel du mode de vie de leurs ancêtres. Ils furent les seuls vertébrés terrestres jusqu'au début du
carbonifère, il y a 365 millions d'années. On appelle d'ailleurs cette période l'âge des amphibiens. Certains d'entre eux pouvaient mesurer plus de 4 m. Vers la fin du
carbonifère, le nombre des amphibiens commença à diminuer, notamment avec l'apparition des reptiles. Au milieu du trias, il y a 230 millions d'années, les survivants des
amphibiens ressemblaient déjà aux espèces actuelles.
5
DIVERSITÉ ET RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
On connaît aujourd'hui environ 6 200 espèces d'amphibiens. La grande majorité des espèces sont petites et mesurent moins de 20 cm, mais, au Japon, il existe une
salamandre géante qui mesure près de 1,50 m.
On trouve les anoures dans le monde entier, alors que les urodèles ne fréquentent que l'hémisphère Nord. Les apodes, eux, ne vivent que sous les tropiques. Quelques
amphibiens vivent en haute montagne et certains atteignent le cercle polaire. On observe une grande diversité dans les modes de vie, aquatique, terrestre ou arboricole.
6
CLASSIFICATION SCIENTIFIQUE
On distingue trois groupes d'amphibiens : les anoures, les urodèles et les apodes.
6.1
Les urodèles : salamandres et tritons
Les urodèles ont une forme allongée et gardent leur queue toute leur vie. Salamandres et tritons se distinguent principalement par leur mode de vie : les premières sont
terrestres, tandis que les seconds passent toute leur vie dans l'eau.
6.2
Les anoures : grenouilles, rainettes, crapauds
Les anoures ont un corps court et trapu, et sont dépourvus de queue. La peau est lisse chez les grenouilles et les rainettes, verruqueuse, chez les crapauds. Ces derniers
sont en outre plus trapus et moins bien adaptés au saut que les premières.
6.3
Les apodes : cécilies
Les apodes, ou cécilies, n'ont pas de pattes, sont presque aveugles et ressemblent à des vers de terre.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les amphibiens.
- LA CLASSIFICATIONLe 1er classificateur est Aristote qui distingue 2 classes : les animaux avec sang -les animaux sans sang ou à sang incoloreAu 18ème siècle Linné distingue 6 groupes : -les quadrupèdesles oiseaux - les amphibiens- les insectes- les poissons- les vers.
- Amphibiens n.
- Comment est qualifiée la cellule-oeuf des Amphibiens vis-à-vis de sa quantité de réserves vitellines ?