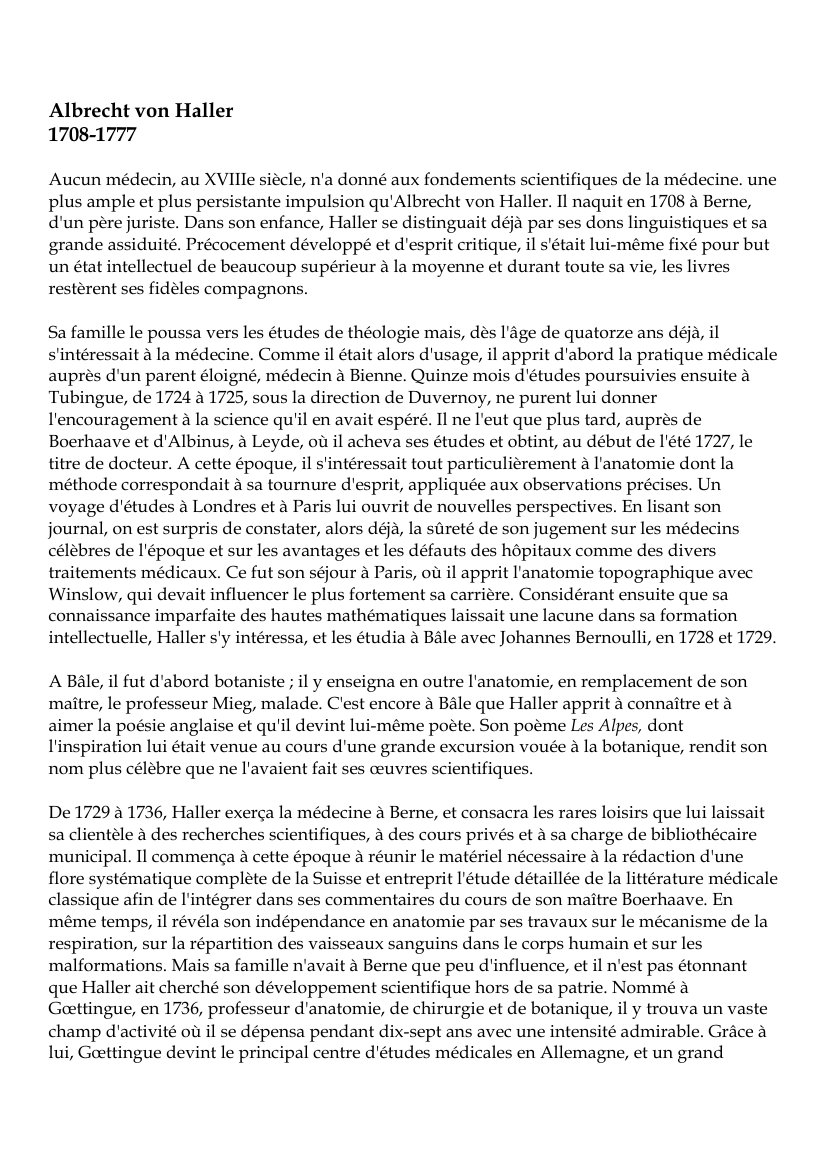Albrecht von Haller1708-1777Aucun médecin, au XVIIIe siècle, n'a donné aux fondements scientifiques de la médecine.
Publié le 22/05/2020
Extrait du document
«
Albrecht von Haller
1708-1777
Aucun médecin, au XVIIIe siècle, n'a donné aux fondements scientifiques de la médecine.
une
plus ample et plus persistante impulsion qu'Albrecht von Haller.
Il naquit en 1708 à Berne,
d'un père juriste.
Dans son enfance, Haller se distinguait déjà par ses dons linguistiques et sa
grande assiduité.
Précocement développé et d'esprit critique, il s'était lui-même fixé pour but
un état intellectuel de beaucoup supérieur à la moyenne et durant toute sa vie, les livres
restèrent ses fidèles compagnons.
Sa famille le poussa vers les études de théologie mais, dès l'âge de quatorze ans déjà, il
s'intéressait à la médecine.
Comme il était alors d'usage, il apprit d'abord la pratique médicale
auprès d'un parent éloigné, médecin à Bienne.
Quinze mois d'études poursuivies ensuite à
Tubingue, de 1724 à 1725, sous la direction de Duvernoy, ne purent lui donner
l'encouragement à la science qu'il en avait espéré.
Il ne l'eut que plus tard, auprès de
Boerhaave et d'Albinus, à Leyde, où il acheva ses études et obtint, au début de l'été 1727, le
titre de docteur.
A cette époque, il s'intéressait tout particulièrement à l'anatomie dont la
méthode correspondait à sa tournure d'esprit, appliquée aux observations précises.
Un
voyage d'études à Londres et à Paris lui ouvrit de nouvelles perspectives.
En lisant son
journal, on est surpris de constater, alors déjà, la sûreté de son jugement sur les médecins
célèbres de l'époque et sur les avantages et les défauts des hôpitaux comme des divers
traitements médicaux.
Ce fut son séjour à Paris, où il apprit l'anatomie topographique avec
Winslow, qui devait influencer le plus fortement sa carrière.
Considérant ensuite que sa
connaissance imparfaite des hautes mathématiques laissait une lacune dans sa formation
intellectuelle, Haller s'y intéressa, et les étudia à Bâle avec Johannes Bernoulli, en 1728 et 1729.
A Bâle, il fut d'abord botaniste ; il y enseigna en outre l'anatomie, en remplacement de son
maître, le professeur Mieg, malade.
C'est encore à Bâle que Haller apprit à connaître et à
aimer la poésie anglaise et qu'il devint lui-même poète.
Son poème Les Alpes, dont
l'inspiration lui était venue au cours d'une grande excursion vouée à la botanique, rendit son
nom plus célèbre que ne l'avaient fait ses œ uvres scientifiques.
De 1729 à 1736, Haller exerça la médecine à Berne, et consacra les rares loisirs que lui laissait
sa clientèle à des recherches scientifiques, à des cours privés et à sa charge de bibliothécaire
municipal.
Il commença à cette époque à réunir le matériel nécessaire à la rédaction d'une
flore systématique complète de la Suisse et entreprit l'étude détaillée de la littérature médicale
classique afin de l'intégrer dans ses commentaires du cours de son maître Boerhaave.
En
même temps, il révéla son indépendance en anatomie par ses travaux sur le mécanisme de la
respiration, sur la répartition des vaisseaux sanguins dans le corps humain et sur les
malformations.
Mais sa famille n'avait à Berne que peu d'influence, et il n'est pas étonnant
que Haller ait cherché son développement scientifique hors de sa patrie.
Nommé à
Gœ ttingue, en 1736, professeur d'anatomie, de chirurgie et de botanique, il y trouva un vaste
champ d'activité où il se dépensa pendant dix-sept ans avec une intensité admirable.
Grâce à
lui, G œ ttingue devint le principal centre d'études médicales en Allemagne, et un grand.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le rationalisme du XVIIIe siècle par Jean StarobinskiProfesseur à l'Université Johns Hophins, Baltimore Ils se sont donné le nom de Philosophes.
- La médecine au XVIIe siècle par Ernest WickersheimerStrasbourg L'amour médecin, Le Médecin malgré lui, Monsieur de Pourceaugnac : fantochesde noir habillés, chapeaux pointus.
- Étude de cas en histoire moderne: Révoltes et troubles sociaux à la fin du XVIIIe siècle
- LES FOYERS DE LA VIE INTELLECTUELLE AU XVIIIe siècle
- Comment les philosophes du XVIIIe siècle, notamment Montesquieu et Voltaire, utilisent-ils l'arme de l'ironie ?