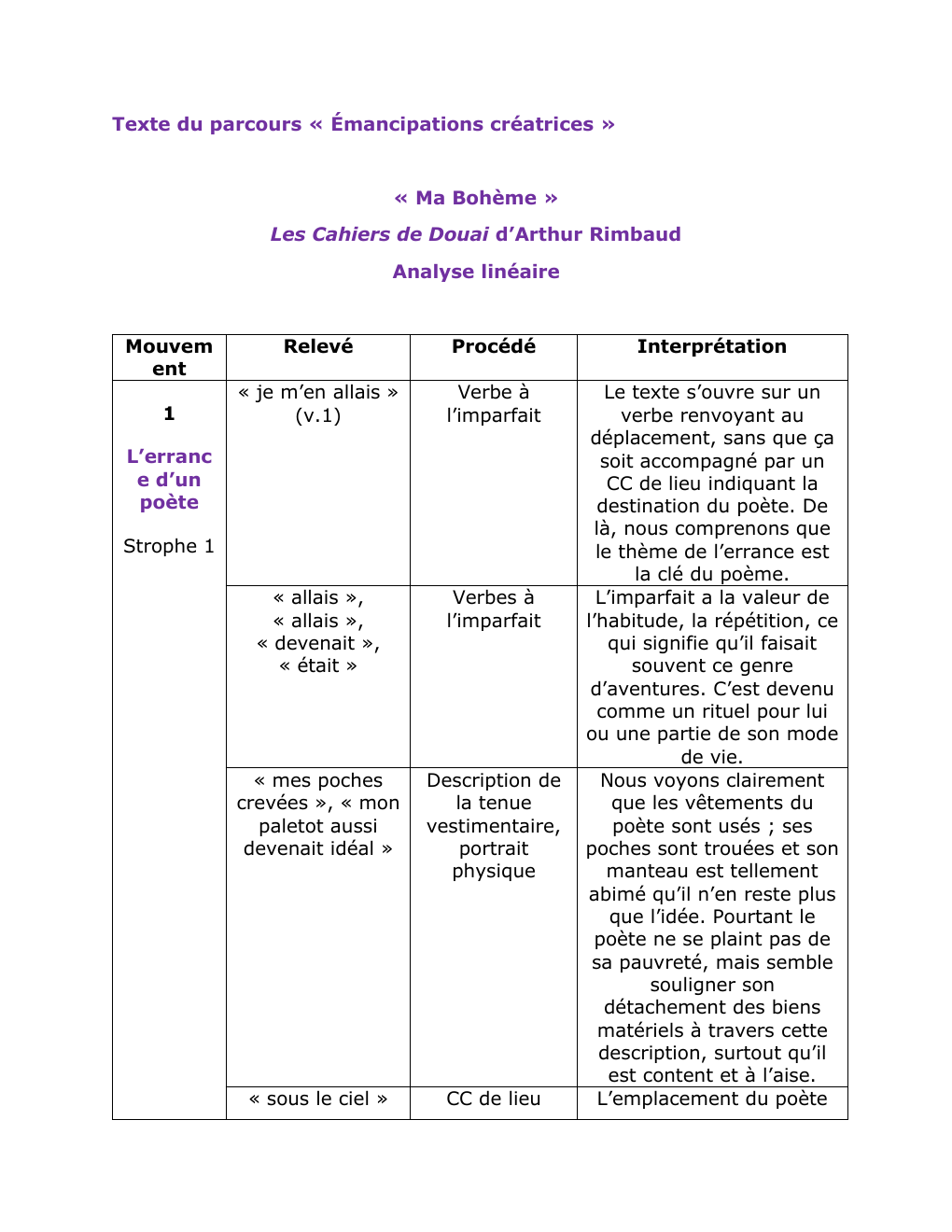« Ma Bohème » Les Cahiers de Douai d’Arthur Rimbaud Analyse linéaire
Publié le 26/03/2025
Extrait du document
«
Texte du parcours « Émancipations créatrices »
« Ma Bohème »
Les Cahiers de Douai d’Arthur Rimbaud
Analyse linéaire
Mouvem
ent
1
Relevé
Procédé
Interprétation
« je m’en allais »
(v.1)
Verbe à
l’imparfait
« allais »,
« allais »,
« devenait »,
« était »
Verbes à
l’imparfait
« mes poches
crevées », « mon
paletot aussi
devenait idéal »
Description de
la tenue
vestimentaire,
portrait
physique
« sous le ciel »
CC de lieu
Le texte s’ouvre sur un
verbe renvoyant au
déplacement, sans que ça
soit accompagné par un
CC de lieu indiquant la
destination du poète.
De
là, nous comprenons que
le thème de l’errance est
la clé du poème.
L’imparfait a la valeur de
l’habitude, la répétition, ce
qui signifie qu’il faisait
souvent ce genre
d’aventures.
C’est devenu
comme un rituel pour lui
ou une partie de son mode
de vie.
Nous voyons clairement
que les vêtements du
poète sont usés ; ses
poches sont trouées et son
manteau est tellement
abimé qu’il n’en reste plus
que l’idée.
Pourtant le
poète ne se plaint pas de
sa pauvreté, mais semble
souligner son
détachement des biens
matériels à travers cette
description, surtout qu’il
est content et à l’aise.
L’emplacement du poète
L’erranc
e d’un
poète
Strophe 1
(v.3)
est identifié ; il est dans la
nature, mais en même
temps, c’est un lieu qui
n’est pas précis, d’où
l’insistance sur le thème
du vagabondage.
Rimbaud
interpelle la muse et
« Muse »
Apostrophe
ème
se met à son service, il
« ton féal »
2
pers.
du
confirme
donc son identité de
sing.
poète.
Toutefois, il tutoie la
muse qui est une divinité.
Cela suppose in lien de
familiarité.
Là nous voyons la
relation spéciale que Rimbaud
à la poésie.
Cette interjection renvoie au
« Oh là là ! » (v.
Interjection
plaisir qu’éprouve Rimbaud
4)
dans l’errance.
En dépit de sa
pauvreté, il savoure chaque
instant d’errance dans la
nature.
Cette
phrase
confirme son
Que d’amours
Phrase
plaisir qui nait d’une joie
splendides j’ai
exclamative
retrouvée
dans la rêverie,
rêvées !»
donc le détachement de la
réalité.
TRANSITION : Au terme de cette strophe, le poète est donc libéré d’un
point de vue physique puisqu’il erre dans la nature, d’un point de vue
matériel puisqu’il est insouciant de sa pauvreté, mais aussi d’un point de
vue moral puisqu’il s’abandonne à la rêverie.
« culotte »,
connotation
Le poète poursuit avec
2
« large trou »
l’idée de la pauvreté sur
(v.5)
une tonalité grotesque,
La
propre à l’insouciance de
création
l’adolescence.
poétique
« Petit-Poucet
Métaphore
Rimbaud se compare à un
rêveur » (v.
6)
personnage d’un conte
Strophes
merveilleux.
Il se
2, 3
reconnait poète précoce et
souligne son attachement
à sa jeunesse, à la rêverie
infantile, qui l’emmène
vers un monde
merveilleux.
Cette métaphore fait
également écho aux
problèmes familiaux de
Rimbaud et à sa mauvaise
relation à sa mère,
puisque le Petit Poucet est
celui qui est abandonné
par ses parents.
« des rimes »
Rejet
Mise en valeur de la
poésie par le biais du
rejet.
C’est une poésie qui
nait de la « course » donc
du vagabondage.
En plus, les rimes sont
« rejetées » un peu de la
même manière dont le
Petit Poucet jette ses
cailloux… c’est donc une
mise en valeur de la
métaphore (rimescailloux).
« à la GrandeCC Lieu
Le fait de choisir la
Ourse »
constellation de la GrandeOurse pour auberge
signifie qu’il n’a
pratiquement pas
d’auberge… il dort à la
belle étoile, dans la
nature.
En outre, Rimbaud
met en valeur de nouveau
le thème de l’errance vu
que la Grande-Ourse est
connue pour être le repère
principal des voyageurs.
« Mes étoiles au
Personnification
Les étoiles sont
ciel avaient un
comparées à des femmes
doux frou-frou »
vêtues de robes qui
(v.
8)
foisonnent.
+ L’emploi du
déterminant possessif
« mon », il s’approprie les
étoiles, comme si la
nature lui appartient.
Il
est en fusion avec la
nature.
« et je les
écoutais assis au
bord des routes »
(v.
9)
Enjambement
Dans un sonnet classique,
les tercets doivent
s’opposer du point de vue
thématique aux quatrains,
or, ici, le 1er tercet
commence par un
enjambement qui le lie
thématiquement au
quatrain qui le précède.
On voit donc que Rimbaud
se permet une marge de
liberté au niveau de la
prosodie.
La personnification des
étoiles est prolongée
jusqu’à la troisième
strophe.
+ synesthésie
(correspondance des sens)
puisqu’il entend les
étoiles, donc c’est une
correspondance entre la
vision et l’ouïe.
« Ces bons soirs
CC temps
Le mois de septembre
de septembre »
correspond à la date de sa
première fugue.
Au niveau
symbolique, c’est le mois
des vendanges, la récolte
du raisin pour la
préparation du vin.
« des gouttes de
comparaison
La rosée le désaltère et lui
rosée à mon
donne même de la joie et
front, comme un
de l’énergie, tel un vin.
Là
vin de vigueur »
également il y a
synesthésie entre le
toucher et le goût.
Cette figure permet
également de confirmer la
comparaison de la nature
à une auberge (v.
7) qui
accueille et offre des
boissons.
Transition : Rimbaud s’évade dans la nature pour créer de la poésie, c’est
pourquoi son art se veut également libre et refuse les contraintes imposées
par les règles et les conventions.
3
Une
liberté
poétique
« où rimant au
milieu des
ombres
fantastiques »
Enjambement
Strophe 4
« où rimant....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- analyse linéaire de « Alchimie du verbe » d’Arthur Rimbaud.
- Arthur Rimbaud, « Vénus anadyomène », Les Cahiers de Douai, 1870, EAF
- Les ponts, Arthur Rimbaud : analyse linéaire
- Présentation des cahiers de douai de Rimbaud
- analyse linéaire "Le Mal" de Rimbaud