MAZZINI Giuseppe
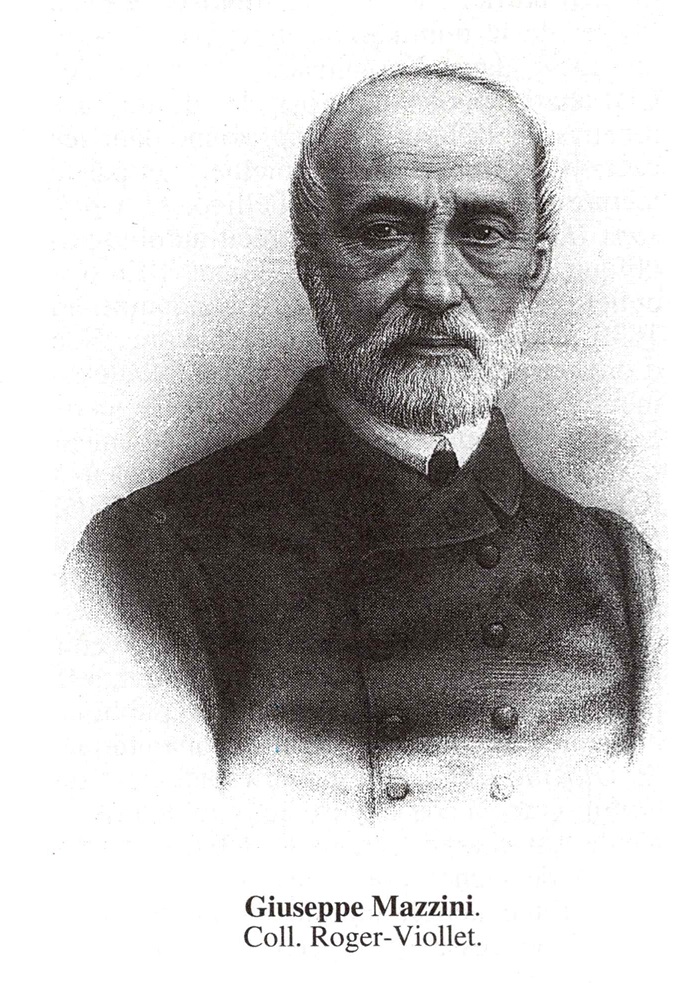 MAZZINI Giuseppe. Patriote et écrivain politique italien. Né à Gênes le 22 juin 1805, mort à Pise le 10 mars 1872. Esprit inquiet, il lut assidûment, surtout Dante et Foscolo. Au mois d’avril 1821, alors qu’il se trouvait avec sa mère à Gênes, il rencontra un homme qui quêtait pour les « proscrits d’Italie », c’est-a-dire les vaincus, ceux dont la résistance annonçait la révolte proche de la nation opprimée et démembrée. A partir de ce jour, Mazzini sentit son destin se lier à celui de sa patrie. Il s’affilia aux Carbonari et commença d’écrire dans un journal dont la publication fut interdite parce qu’il portait ombrage au gouvernement et à l’Eglise. Mazzini se tourna alors vers L’Indicateur de Livourne [L’Indicatore Livornese], périodique également supprimé peu après pour des raisons identiques. Trahi par le chef des Carbonari qui l’avait initié aux « travaux » de l’association, il fut arrêté à la fin de 1830 et enfermé à la forteresse de Savone. Il en sortit quelques mois plus tard pour passer en Suisse et commencer sa carrière d’exilé et de conspirateur.
De Genève, Giuseppe Mazzini se rendit à Lyon où il fut accueilli par des patriotes, et où il se mit à préparer une expédition pour l’invasion de la Savoie. Cependant, le gouvernement de Paris, qui aspirait à la paix, donna ordre que les préparatifs fussent interrompus. Mazzini dut se réfugier en Corse, d’où il se proposait de se porter, avec quelques autres conjurés, vers l'Italie centrale, qui venait de se révolter contre les gouvernements de Modène, de Parme, de Rome. Mais avant qu’il eût pu réunir les moyens nécessaires, l’insurrection était réprimée par les armées autrichiennes et Mazzini retourna en France, fondant à Marseille le groupe « Jeune Italie » [« Giovine Italia »] dont l’unique but était d’aider l’Italie à acquérir son indépendance. Cette « Jeune Italie » avait une doctrine, un programme d’éducation nationale, et la jeunesse reconnut bientôt en Mazzini l’ardeur, la générosité que peuvent donner une foi désintéressée et une grande noblesse naturelle. Mazzini s’éprit juste à ce moment de la veuve d’un patriote exilé, Giuditta Sidoli, et en eut un fils qui mourut en bas âge.
Mazzini et le groupe de la « Jeune Italie » résolurent alors de préparer la révolution en Sardaigne, et tentèrent de gagner les soldats de l’armée royale; le complot fut une fois de plus découvert, et bon nombre de patriotes turent arrêtés et condamnés à mort. Alors que Garibaldi, découragé par les défections, se réfugiait outre-Atlantique, Mazzini refusa de céder, et prépara l’invasion de la Savoie avec des exilés italiens, polonais et allemands réfugiés à Genève. Bien que la tentative se fût soldée par un échec, Mazzini, toujours certain d’avoir à remplir une mission, se cacha en Suisse; les gouvernements de Turin, de Vienne, de Paris insistèrent auprès du « Vorort » pour qu’il fût expulsé. En réponse à cette coalition des gouvernements monarchiques, un groupe d’exilés, pauvres, persécutés, se laissa séduire par l’idée de Mazzini, et signa avec lui, à Berne, le 15 avril 1834, un pacte solennel pour la création d’une « Jeune Europe » [« Giovine Europa »]. De 1835 date Foi et avenir, écrit en français. Un an plus tard, à l’issue d’une crise où il avait douté de lui-même et de son œuvre, Mazzini se vit contraint de quitter la Suisse, et chercha refuge en Angleterre. En proie à de multiples difficultés, il réussit malgré tout à collaborer à des revues et à des journaux anglais, à se faire des amis, à continuer ses menées politiques. Il fonda un journal, l'Apostolat populaire [Apostolato popolare], créa une école où il accueillit de jeunes Italiens rencontrés dans les rues, soutint, par des centaines de lettres, la conspiration qui s’étendait à toute l’Italie. Différentes tentatives extrêmement audacieuses échouèrent l’une après l’autre, dont Plusieurs débarquements dans le sud de Italie. La haine qu’inspirait l’Autriche ne faisait que grandir, ainsi que l’urgence de réformes politiques tendant à établir l’union nationale. Avec la mort de Grégoire XVI et l’élection de Pie IX, commença la véritable révolution; tant à Païenne qu’à Venise, Milan, Naples, Rome, les Italiens se battirent pour obtenir l’indépendance. Mazzini accourut, en 1848, il prêcha la guerre. Elu triumvir à Rome ou était proclamée la République, il résista aux forces envoyées par la France et par l’Autriche. Tout son programme tenait en une formule : « Dieu et le peuple. » A l’issue de combats sans fin, où les uns et les autres triomphèrent alternativement, on proclama l'avènement du Royaume d’Italie (1861). Mais l’Italie de Cavour n’était point celle de Mazzini. Déjà condamné à mort deux fois, parce qu’il continuait à faire partie de l’opposition et qu’il stigmatisait la politique monarchique, Mazzini vivait en exilé, dans sa patrie, avec un passeport anglais et sous un faux nom. Il continuait de prêcher une doctrine à la fois mystique et républicaine, et refusait de pactiser avec le socialisme marxiste. Affligé, malade, prématurément vieilli, Mazzini mourut à Pise. Ses Ecrits [Scritti] furent publiés par l’éditeur G. Daelli de Milan, en dix-huit volumes dont sept furent revus par l’auteur lui-même. Puis une commission nationale s’occupa de faire paraître Les Ecrits publiés et inédits de Mazzini [Scritti editi e inediti de Mazzini, 1906-1927] divisés en trois séries : Politique, Littérature, Correspondance — et ses Lettres —, en quarante-huit volumes, auxquels il faut ajouter six volumes contenant le Protocole de la jeune Italie [Protocolo della Giovine Italia].
MAZZINI Giuseppe. Patriote et écrivain politique italien. Né à Gênes le 22 juin 1805, mort à Pise le 10 mars 1872. Esprit inquiet, il lut assidûment, surtout Dante et Foscolo. Au mois d’avril 1821, alors qu’il se trouvait avec sa mère à Gênes, il rencontra un homme qui quêtait pour les « proscrits d’Italie », c’est-a-dire les vaincus, ceux dont la résistance annonçait la révolte proche de la nation opprimée et démembrée. A partir de ce jour, Mazzini sentit son destin se lier à celui de sa patrie. Il s’affilia aux Carbonari et commença d’écrire dans un journal dont la publication fut interdite parce qu’il portait ombrage au gouvernement et à l’Eglise. Mazzini se tourna alors vers L’Indicateur de Livourne [L’Indicatore Livornese], périodique également supprimé peu après pour des raisons identiques. Trahi par le chef des Carbonari qui l’avait initié aux « travaux » de l’association, il fut arrêté à la fin de 1830 et enfermé à la forteresse de Savone. Il en sortit quelques mois plus tard pour passer en Suisse et commencer sa carrière d’exilé et de conspirateur.
De Genève, Giuseppe Mazzini se rendit à Lyon où il fut accueilli par des patriotes, et où il se mit à préparer une expédition pour l’invasion de la Savoie. Cependant, le gouvernement de Paris, qui aspirait à la paix, donna ordre que les préparatifs fussent interrompus. Mazzini dut se réfugier en Corse, d’où il se proposait de se porter, avec quelques autres conjurés, vers l'Italie centrale, qui venait de se révolter contre les gouvernements de Modène, de Parme, de Rome. Mais avant qu’il eût pu réunir les moyens nécessaires, l’insurrection était réprimée par les armées autrichiennes et Mazzini retourna en France, fondant à Marseille le groupe « Jeune Italie » [« Giovine Italia »] dont l’unique but était d’aider l’Italie à acquérir son indépendance. Cette « Jeune Italie » avait une doctrine, un programme d’éducation nationale, et la jeunesse reconnut bientôt en Mazzini l’ardeur, la générosité que peuvent donner une foi désintéressée et une grande noblesse naturelle. Mazzini s’éprit juste à ce moment de la veuve d’un patriote exilé, Giuditta Sidoli, et en eut un fils qui mourut en bas âge.
Mazzini et le groupe de la « Jeune Italie » résolurent alors de préparer la révolution en Sardaigne, et tentèrent de gagner les soldats de l’armée royale; le complot fut une fois de plus découvert, et bon nombre de patriotes turent arrêtés et condamnés à mort. Alors que Garibaldi, découragé par les défections, se réfugiait outre-Atlantique, Mazzini refusa de céder, et prépara l’invasion de la Savoie avec des exilés italiens, polonais et allemands réfugiés à Genève. Bien que la tentative se fût soldée par un échec, Mazzini, toujours certain d’avoir à remplir une mission, se cacha en Suisse; les gouvernements de Turin, de Vienne, de Paris insistèrent auprès du « Vorort » pour qu’il fût expulsé. En réponse à cette coalition des gouvernements monarchiques, un groupe d’exilés, pauvres, persécutés, se laissa séduire par l’idée de Mazzini, et signa avec lui, à Berne, le 15 avril 1834, un pacte solennel pour la création d’une « Jeune Europe » [« Giovine Europa »]. De 1835 date Foi et avenir, écrit en français. Un an plus tard, à l’issue d’une crise où il avait douté de lui-même et de son œuvre, Mazzini se vit contraint de quitter la Suisse, et chercha refuge en Angleterre. En proie à de multiples difficultés, il réussit malgré tout à collaborer à des revues et à des journaux anglais, à se faire des amis, à continuer ses menées politiques. Il fonda un journal, l'Apostolat populaire [Apostolato popolare], créa une école où il accueillit de jeunes Italiens rencontrés dans les rues, soutint, par des centaines de lettres, la conspiration qui s’étendait à toute l’Italie. Différentes tentatives extrêmement audacieuses échouèrent l’une après l’autre, dont Plusieurs débarquements dans le sud de Italie. La haine qu’inspirait l’Autriche ne faisait que grandir, ainsi que l’urgence de réformes politiques tendant à établir l’union nationale. Avec la mort de Grégoire XVI et l’élection de Pie IX, commença la véritable révolution; tant à Païenne qu’à Venise, Milan, Naples, Rome, les Italiens se battirent pour obtenir l’indépendance. Mazzini accourut, en 1848, il prêcha la guerre. Elu triumvir à Rome ou était proclamée la République, il résista aux forces envoyées par la France et par l’Autriche. Tout son programme tenait en une formule : « Dieu et le peuple. » A l’issue de combats sans fin, où les uns et les autres triomphèrent alternativement, on proclama l'avènement du Royaume d’Italie (1861). Mais l’Italie de Cavour n’était point celle de Mazzini. Déjà condamné à mort deux fois, parce qu’il continuait à faire partie de l’opposition et qu’il stigmatisait la politique monarchique, Mazzini vivait en exilé, dans sa patrie, avec un passeport anglais et sous un faux nom. Il continuait de prêcher une doctrine à la fois mystique et républicaine, et refusait de pactiser avec le socialisme marxiste. Affligé, malade, prématurément vieilli, Mazzini mourut à Pise. Ses Ecrits [Scritti] furent publiés par l’éditeur G. Daelli de Milan, en dix-huit volumes dont sept furent revus par l’auteur lui-même. Puis une commission nationale s’occupa de faire paraître Les Ecrits publiés et inédits de Mazzini [Scritti editi e inediti de Mazzini, 1906-1927] divisés en trois séries : Politique, Littérature, Correspondance — et ses Lettres —, en quarante-huit volumes, auxquels il faut ajouter six volumes contenant le Protocole de la jeune Italie [Protocolo della Giovine Italia].
♦ « Lui seul veillait quand tous dormaient... » Garibaldi. ♦ « Un grand homme, dans le langage courant, n ’a besoin d'être ni bon ni noble — je ne me souviens que d’un seul homme en ce siècle à qui ces trois qualificatifs aient été décernés, même par ses ennemis : Mazzini. » Nietzsche.
Mazzini, Giuseppe (Gênes 1805-Pise 1872) ; homme politique italien.
Fils d’un professeur de médecine, M., par sa vision à long terme et sa fermeté, est l’une des figures les plus importantes et les plus originales du Risorgimento italien. Son éducation est marquée par l’atmosphère idéaliste libérale et en même temps profondément religieuse de la maison familiale. Même s’il prend par la suite des distances avec l’Église, M. conserve une religiosité profonde jusqu’à sa mort. Il est ainsi convaincu que Dieu l’a chargé d’une mission particulière pour laquelle il est prêt au sacrifice suprême. C’est pourquoi il vivra jusqu’à la fin dans la plus grande austérité, renonçant à son pays et à sa famille, aux honneurs et à la sécurité financière. Après de brèves études de droit, il se donne pour tâche d’unifier l’Italie, de la rénover et de la libérer de la domination étrangère. Il entre en 1828 dans l’organisation secrète des Carbonari, bouleversé par le destin des rebelles de 1821 qu’on emprisonne dans les cachots de Venise ou du Spielberg, et par la lecture du livre de Silvio Pellico, Mes prisons (Le mie Prigioni), un récit autobiographique qui émeut profondément l’Europe entière. Lorsque Mazzini est condamné en 1830 à six mois de prison à Savone, il a d’ores et déjà compris que seul un soulèvement national général émanant de la jeune génération pourra provoquer un changement radical de la réalité italienne. Renonçant à l’aide de puissances étrangères - « L’Italia farà da sè » reste la devise controversée du Risorgimento - M. fonde en 1831 la Giovine Italia qui doit, par une série de soulèvements et de révoltes sans cesse attisés, venir peu à peu à bout de la domination étrangère pour construire finalement la République italienne ; M. refuse le régime monarchique. Sa Giovine Italia, qui gagne rapidement du terrain grâce à son intense activité de propagande, est chargée depuis le début non seulement de tâches politiques concrètes mais aussi d’une action morale et intellectuelle dont il ne cesse de répéter les trois idées principales. Il espère d’abord qu’elle parviendra dans son élan à secouer la grande masse du peuple pour le sortir de sa fatale inerzia, de son oisiveté, de sa paresse intellectuelle et de sa faiblesse, dans lesquelles il voit, comme Gioberti, le principal obstacle à là liberté. Il donne au concept de vertu de Machiavel, qu’il déteste profondément, son sens plein quand il parle de l’assurance et de la force morale de l’esprit, qui est à la fois pensée et action : Pensiero e azione, pour citer le titre d’un de ses manifestes. La Giovine Italia a pour seconde tâche de renouveler le concept de l’État. Rejetant le régime absolutiste autant que la « volonté générale » de Rousseau, M. conçoit l’Etat comme une communauté morale : il est du devoir de l’Etat de soumettre la politique intérieure comme la politique extérieure à la loi morale et de protéger les citoyens dans leur contribution au progrès de l’humanité, afin que la volonté divine se réalise dans l’histoire. Troisièmement enfin, M. estime que l’Etat national tant attendu ne prendra tout son sens qu’en participant à la réalisation de la mission supranationale de l’humanité. L’Italie nouvelle, troisième Rome (Terza Roma), doit succéder à la Rome des empereurs et des papes et unir tous les peuples dans une confédération des nations. M. n’a pas élaboré son propre système de pensée : il a cherché dans les œuvres de Dante, Vico, Herder, Schiller, Hegel et beaucoup d’autres, les idées qui correspondaient aux siennes et pouvaient susciter l’enthousiasme de ses partisans dans des pamphlets toujours renouvelés. Pour servir l’unité de l’humanité qui est son idée la plus chère, il fonde en 1834 la Giovine Europa, qui ne sera que feu de paille. La Giovine Italia elle-même ne rencontre sur son chemin que peu de succès concrets, mais voit bon nombre de ses meilleurs défenseurs exécutés, proscrits ou incarcérés. Condamné en 1832 deux fois à mort, plusieurs fois au cachot et frappé de bannissement, M. vit presque exclusivement en exil à partir de 1834 (le plus souvent à Londres à partir de 1850), ne rentrant brièvement au pays que pour y diriger ses révoltes. Malgré sa participation, trois mois durant, au triumvirat de la République romaine de 1848, il perd de plus en plus le contact avec son peuple. Après l’unité de l’Italie, réalisée par Cavour à l’encontre de ses idéaux, il rentre en 1869 et vit sous un nom d’emprunt comme un banni dans son propre pays. Il ne mesure pas l’importance de sa contribution à l’édification spirituelle de l’Italie nouvelle qui le considérera plus tard officiellement comme le père de la démocratie. Il meurt le 10 mars 1872, réconforté par sa seule foi en une vie éternelle.
Homme politique italien. Fondateur de la Jeune-Italie, société secrète qui se donnait pour objectifs la libération et l'unification de l'Italie, ainsi que l'instauration de la république. Condamné à mort par les Autrichiens, il se réfugia à Berne en 1834, où il fonda la Jeune-Europe qui devait inspirer tous les complots contre les puissances opprimant sa patrie, puis à Londres en 1837. Dès l'annonce de la révolution de 1848, il accourut à Naples pour animer la résistance contre les Autrichiens. À la tête d'un triumvirat, il dirigea la République romaine proclamée par ses partisans (9 févr. 1849). Mais en juin 1849, il dut s'enfuir devant les troupes françaises. Ses diverses tentatives ultérieures furent autant d'échecs et son influence diminua, après que nombre de ses partisans, dont Garibaldi, se furent ralliés à la maison de Savoie.
MAZZINI, Giuseppe (Gênes, 1805 ou 1808-Pise, 1872). Patriote italien, il fut l'un des promoteurs de l'unité italienne. Compromis avec les carbonari, il se réfugia en France ( 1831 ) où il fonda le mouvement Jeune-Italie, société secrète destinée à libérer l'Italie de la domination autrichienne, afin d'y établir une République unitaire. Après plusieurs conspirations et insurrections manquées contre l'Autriche (1833-1837), Mazzini s'installa à Londres où il publia Foi et avenir (1835) et Devoirs de l'homme (1837). Rentré en Italie en 1848, il participa à la fondation de la République à Rome (1849) jusqu'au rétablissement de l'autorité pontificale par les troupes françaises d'Oudinct. Exilé à l'étranger, Mazzini poursuivit ses activités de conspirateur, puis fut arrêté en Sicile en 1870. Amnistié, il mourut peu après. Voir Carbonarisme, Cavour (Camillo Benso, comte de), Gioberti (Vincenzo), Risorgimento.































