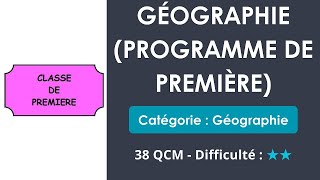Malgré ses évolutions, le financement du développement reste inadapté aux besoins des pays pauvres
Malgré ses évolutions, le financement du développement reste inadapté aux besoins des pays pauvres
Le financement extérieur du développement est constitué d’une grande variété de flux publics et privés allant du don aux prêts à taux de marché. La combinaison de ces divers flux s’est modifiée sans cesse en fonction de deux grandes tendances : la place grandissante des marchés financiers internationaux - la globalisation financière [voir « La globalisation financière a profondément modifié le fonctionnement de l’économie mondiale »]- et la différenciation de plus en plus marquée des pays en développement.
Jusqu’en 1929, le financement du développement était assuré par des petits épargnants qui souscrivaient directement des titres émis par les collectivités publiques ou des entreprises privées, notamment pour la réalisation de grands travaux d’infrastructure. Les guerres, puis la crise de 1929 ont provoqué l’insolvabilité de beaucoup des ces collectivités. Malgré des négociations complexes et longues (elles se termineront dans le milieu des années 1950), une partie de l’épargne ainsi investie sera perdue.
En 1944, après le New Deal, la foi dans les vertus de l’intervention publique était à son sommet. Des institutions internationales furent créées à Bretton Woods pour gérer le Système monétaire international (Fonds monétaire international, FMI) et financer le développement sur une base multilatérale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, plus connue sous le nom de Banque mondiale). À ces institutions s’ajoutèrent des banques régionales de développement et des institutions nationales de financement du développement (financement bilatéral). La réussite du plan Marshall, en 1947, devint le mythe fondateur de cette approche du financement du développement, selon laquelle un apport massif de capital public extérieur peut accélérer la croissance. Par la suite, lors de chaque choc économique, il se trouvera toujours quelqu’un pour réclamer « un plan Marshall »- même si la reconstruction européenne et le décollage des jeunes nations sont deux choses bien différentes.
Montée en puissance du financement privé bancaire
Les organismes publics monopolisèrent alors le financement du développement, sous forme de financement de projets. La quasi-immobilité des capitaux à l’époque, notamment en raison d’un système de changes fixes, ne laissait guère d’alternative. Les financements fournis étaient censés combler les déficits d’épargne et de devises, levant ainsi les blocages au développement.
Les années 1970 virent la montée en puissance du financement privé par les banques. L’abondance de liquidités, encore accrue par l’expansion des pétrodollars après 1973, contraignait les banques à rechercher des placements rémunérateurs et fiscalement avantageux. Les pays en développement recherchaient pour leur part des financements moins contraignants, même s’ils étaient plus coûteux. Le crédit bancaire accordé aux États devint progressivement la forme dominante du financement du développement. Il en résulta une croissance rapide de l’endettement des pays du Sud, dans un contexte de croissance assez vive de la plupart de ces économies et de taux d’intérêt réels négatifs.
L’augmentation brutale des taux d’intérêt, due à la modification de la politique monétaire des États-Unis en 1980, et la récession qui s’ensuivit firent éclater cette bulle financière. La crise de l’endettement se déclencha en 1982 quand le Mexique se retrouva au bord de la faillite. Les organismes publics (le FMI, la Banque mondiale, avec l’appui déterminant du Trésor des États-Unis) ne purent combler que très partiellement le reflux du financement bancaire. En l’absence de prêts nouveaux, les pays très endettés durent faire face à des transferts financiers négatifs, leur service de la dette étant supérieur aux nouveaux emprunts.
Crise de la dette et politiques d’ajustement structurel
Les organisations internationales cherchèrent à rétablir la solvabilité des économies des pays en développement en leur imposant des programmes d’ajustement structurel. Ces plans d’austérité visant à rééquilibrer les balances des paiements pesèrent sur la reprise économique et eurent un impact social négatif. Il fallut attendre 1989 pour qu’un règlement comportant un abandon partiel des créances soit imposé aux banques privées par le secrétaire d’État américain au Trésor (plan Brady). Parallèlement, les pays les plus pauvres bénéficièrent de traitements de leur dette de plus en plus favorables par le Club de Paris, qui réunit les grands États créanciers. Après la réunion du G-7 (Groupe des sept pays les plus industrialisés) à Toronto en 1988, une partie des échéances fut annulée et la part des dons et des prêts à faible taux dans le financement des États pauvres augmenta.
Le crédit bancaire aux pays en développement se réduisit, mais les investissements de portefeuille (achats de titres) et les investissements directs, stimulés par les privatisations, connurent un essor sans précédent, très concentré sur les pays émergents. Le fait que les créanciers et les débiteurs soient des opérateurs privés semblait écarter la possibilité de crise. C’était oublier la faiblesse du contrôle des systèmes bancaires des pays émergents, qui avaient laissé les emprunteurs prendre des risques excessifs. La soudaine prise de conscience des dangers encourus conduisit à un nouveau reflux des capitaux privés et à de nouvelles crises (fin 1994 au Mexique et mi-1997 en Thaïlande puis dans toute l’Asie du Sud-Est). La mobilisation des organismes publics, encore une fois fermement encadrés par le Trésor des États-Unis, permit un redressement assez rapide et le sauvetage des investisseurs qui avaient spéculé bien imprudemment. Les polémiques sur les causes de la crise (modifications des anticipations des investisseurs privés ou opacité des politiques suivies et corruption) conduisirent à des jugements opposés sur l’opportunité des mesures imposées : fallait-il augmenter les taux d’intérêt pour retenir les capitaux, au risque de généraliser les faillites et de casser la croissance ?
Quel financement pour quel développement ?
Malgré la succession de périodes d’engouement et de reflux du financement privé, le financement du développement est de plus en plus dominé par les marchés internationaux des capitaux, qui peuvent mobiliser rapidement des montants énormes. L’existence même d’organisations publiques spécialisées est fréquemment remise en cause. La garantie implicite qu’elles donnent aux investisseurs favorise les comportements à risque. Les pays émergents pourraient trouver sur les marchés les montants dont ils ont besoin, à condition que des règles du jeu soient précisées et que la transparence de ces marchés soit bien assurée. Cela implique de mieux discriminer les flux spéculatifs et les investissements à long terme. Si la proposition de taxe sur les transactions de change (« taxe Tobin ») semble difficile à mettre en œuvre, certains pays, comme le Chili, ont pris des mesures pour freiner les flux de capitaux à court terme.
Les pays les plus pauvres n’ont pas ces problèmes. Ils sont purement et simplement exclus des marchés internationaux des capitaux et les organisations publiques spécialisées restent leur seul recours. L’aide ainsi fournie est d’un intérêt indéniable. D’un point de vue financier, elle présente l’avantage d’être relativement stable. Sur le plan économique et social, elle est de plus en plus orientée vers la lutte contre la pauvreté. Mais elle n’a pas prouvé son efficacité pour entraîner la croissance. Malgré les faibles taux d’intérêt des prêts et l’abondance des dons, les remboursements sont très partiels. C’est pourquoi les annulations de dette bilatérale se sont multipliées, et les organisations internationales elles-mêmes, dérogeant à des principes plus que cinquantenaires, ont dû annuler à leur tour une partie de leurs créances. Mais le financement par dons qui en découle logiquement n’est pas sans danger, une logique d’assistance se substituant à celle de développement.
Liens utiles
- Malgré ses évolutions, le financement du développement reste inadapté aux besoins des pays pauvres
- L'urbanisation dans les pays industrialisés et dans les pays en voie de développement.
- A l'aide des documents et de vos connaissances, vous vous efforcerez de mettre en évidence l'ensemble des problèmes posés aux pays en voie de développement par les ressources financières qui leur sont accordées.
- Les stratégies de développement en cours dans les pays du tiers monde sont-elles parvenues à infléchir les rapports de dépendance Nord-Sud?
- Les moyens de transports électriques sont-ils compatibles avec le développement durable ?