HEGEL Georg Wilhelm Friedrich. Philosophe allemand
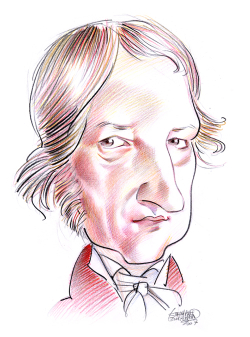 HEGEL Georg Wilhelm Friedrich. Philosophe allemand. Né à Stuttgart le 27 août 1770, mort du choléra le 14 novembre 1831 à Berlin. Une curieuse coïncidence fait naître Hegel l'année même où naquit Hölderlin; c'est ainsi que parurent ensemble dans le monde de l'Allemagne du XVIIIe siècle finissant le poète qui devait exprimer le crépuscule de cet univers et le dépasser par son oeuvre et le philosophe qui tira du romantisme ses accents les plus profonds tout en les encadrant dans une vision rationnelle complètement étrangère à l'inquiétude des romantiques. C'est en vain, toutefois, que l'on chercherait dans la première jeunesse de Hegel les traces ou le bouillonnement d'un « Sturm und Drang » : rien de plus incolore que son adolescence. Fils d'un modeste employé de l'administration ducale, il passa dix-huit ans entre maison paternelle et collège, sans briller, bien qu'il fût un modèle d'attention et de précision, ni par l'intelligence ni par l'imagination. Il lisait beaucoup, et avec une incroyable patience il faisait des extraits de tout ce qu'il avait lu. Nous possédons encore aujourd'hui une partie de ce travail soigneux dans ses cahiers de notes. En 1788, Hegel a dix-huit ans, la Révolution française est imminente et il s'est inscrit aux cours supérieurs de théologie du Séminaire de Tübingen : l'âge, la conjoncture politique, cette nouvelle ambiance accomplirent le miracle d'éveiller en lui les facultés intellectuelles qui, jusqu'alors, y sommeillaient. La connaissance qu'il fit de Hölderlin, également étudiant à Tübingen, contribua pour une large part à cet éveil de sa personnalité. Une immédiate et vive amitié s'établit entre eux. Hegel commence à écrire des méditations, des études et même une poésie, Eleusis, imitée de Hölderlin. Peut-être encore plus décisive est, deux ans plus tard, sa rencontre avec Schelling, de cinq ans son cadet, mais infiniment plus précoce et déjà connu dans les milieux intellectuels. En effet, Schelling s'inscrit aussi aux cours de Tübingen et c'est alors que s'établit entre lui et Hegel un vaste courant d'influences réciproques : Schelling avait une formation romantique, celle de Hegel était au contraire profondément classique, leur rencontre ne pouvait être que fructueuse. La « Stift » de Tübingen avait une vie bien à elle : on peut dire que c'était un moyen terme entre l'Université et le Séminaire : les élèves, en effet, habitaient dans l'institution même où ils étaient surveillés dans leurs études par les « Repetenten » dont c'était le travail. Il régnait dans cet établissement un curieux mélangé de rigueur conventuelle et de liberté universitaire : d'une part, la nourriture y était peu abondante et on y souffrait du froid, d'autre part les étudiants jouissaient d'une grande liberté de pensée et n'étaient pas tenus à la stricte orthodoxie protestante. Ces deux éléments, la rigueur des études et la liberté de pensée influèrent beaucoup sur le caractère du jeune Hegel.
En automne 1793 il obtint son diplôme en théologie, et si on le jugea bon logicien, on lui dénia tout don pour l'éloquence. Pour cette raison, Hegel renonça à la carrière de pasteur, et se dirigea vers celle de précepteur privé; c'était une carrière ennuyeuse, hérissée de difficultés et d'humiliations. Son premier poste fut celui de professeur dans la famille von Streiger, à Berne, l'une des familles les plus aristocratiques de la ville. Hegel accepta bien que ce métier lui déplût, et la solitude de Berne après la vie intense de Tübingen favorisa grandement sa formation intellectuelle. Il commença à lire (ou à relire) La Religion dans les limites de la simple raison de Kant qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait au premier abord peu comprise; elle le transporta dans un univers nouveau pour lui, bien loin de ce monde romantique qui l'avait jusque-là dominé. C'est ainsi qu'il se rapprocha très vite de la morale kantienne, qu'il lut avidement Lessing et Herder et se convertit dans son for intérieur à un rationalisme fondamental qui deviendra la caractéristique de sa philosophie. Le premier fruit de son changement d'orientation est la célèbre Vie de Jésus v. Ecrits de jeunesse sur la théologie rationaliste, et restée inédite jusqu'au XXe siècle. En 1797, Hegel est encore précepteur à Francfort-sur-le-Main, et là, il cherche à concilier les deux tendances et les deux influences opposées qui s'agitaient dans son esprit, d'une part le romantisme dont il s'était imprégné à Tübingen, et de l'autre le rationalisme qui s'était développé en lui au cours de ses méditations solitaires de Berne. L'année suivante se produisait un événement très important : son ami Schelling fut nommé professeur « extraordinaire », sur la recommandation de Niethammer, Fichte et Goethe, à la célèbre université d'Iéna. Cette petite ville était désormais devenue l'un des centres culturels les plus actifs de toute l'Allemagne, grâce surtout à l'oeuvre de Reinhold et de Fichte. Autour d'eux se pressaient un grand nombre de « Privatdozenten » dont quelques-uns promis à la renommée, comme Fries, Krause et d'autres. Mais en 1799-1800 éclata le fameux « Atheismusstreit » (ou débat sur l'athéisme) et Fichte est contraint de quitter léna qui, dès lors, commence à décliner. C'est justement au cours de ces années de discussions, en janvier 1801, que Hegel fut appelé à enseigner à léna, sur la recommandation de Schelling : à partir de ce moment s'ouvrit une ère d'amitié et de collaboration des plus intenses entre Hegel et Schelling. Les articles si connus les plus importants de Hegel sont Foi et science et Sur la méthode scientifique du droit naturel - parus dans le Kritisches Journal der Philosophie, dont ils étaient les directeurs, et dans lesquels Hegel prit la défense de la philosophie de Schelling contre celle de Fichte, en sont les produits. Pendant ce temps, Hegel, dans ses cahiers de notes, expose son système. En effet, le climat universitaire de Iéna a définitivement achevé sa formation spirituelle, les énergies qui étaient latentes en lui se sont ouvertes et développées, et, tandis que Schelling, l'« enfant prodige », bien plus jeune que lui, va vers le déclin, Hegel est sur le point de produire ses meilleures oeuvres. La première d'entre elles ne tarde guère : c'est la célèbre Phénoménologie de l'esprit ; Hegel avait promis de la remettre à l'éditeur en octobre 1806, mais l'occupation d'Iéna par les Français retarda son travail qui fut conclu hâtivement l'année suivante : c'est dans cet état qu'il fut publié à Bamberg et à Würzburg. Dans la préface remarquable de cette oeuvre on note la rupture définitive de Hegel avec les romantiques et avec Schelling.
Après la chute d'Iéna, Hegel connut des difficultés financières et, pour vivre, fut obligé d'accepter l'ingrate tâche de rédiger un quotidien de province, le Bamberger Zeitung. Il fut contraint de demeurer dans cette petite ville sans culture jusqu'en 1808, écrivant à ses amis des lettres remplies d'amertume, jusqu'au jour où, pour le tirer de cette situation difficile, intervint son ami, et aussi celui de Schelling, le puissant Niethammer. Celui-ci avait, justement pendant ces dernières années, mis en oeuvre un projet de réforme des lycées de la Bavière, Hegel fut donc envoyé à Nuremberg, comme proviseur du nouveau lycée classique ou il professa également la philosophie. Ce furent sans doute les années les plus tranquilles et les plus laborieuses de son existence. Il épousa, en 1811, une jeune fille appartenant à la meilleure noblesse de la ville, et il donna, pendant cette période, la Science de la logique et la Propédeutique philosophique [Philosophische Propadeutik]. Cependant la direction d'un lycée ne pouvait être une position adaptée à la valeur et aux ambitions de Hegel; il aspirait à l'enseignement universitaire, et cette aspiration fut satisfaite en 1816, lorsqu'il fut appelé à enseigner la philosophie à l'Université de Heidelberg. Là, il commença à former son école : autour de lui se réunit tout un groupe de disciples, dont quelques-uns, très fidèles, divulgueront son oeuvre dans toute l'Allemagne : Hinrichs, Rosenkranz, Erdmann. Et c'est alors qu'il écrit l'oeuvre qui lui vaudra le plus de gloire : l'Encyclo-pédie des sciences philosophiques; désormais le nom de Hegel circule dans tous les milieux philosophiques, suscitant de chaleureuses approbations mais aussi de violentes réactions. Sa renommée allait toujours croissant et lui fit atteindre le sommet de sa carrière professorale, l'Univer-sité de Berlin : on l'y appela au cours de l'été 1818 et il y enseigna pendant treize ans, jusqu'à sa mort. Durant ses années berlinoises, il fit paraître notamment les Principes de la philosophie du droit (1818) et les Leçons sur la philosophie de l'histoire. Hegel connut les plus grandes satisfactions qu'ait jamais obtenues un philosophe, on accourait de toute l'Allemagne pour assister à ses cours, il fut en rapport avec les plus hautes personnalités littéraires et scientifiques du temps, parmi lesquelles Goethe et Victor Cousin. Il devint peu à peu le maître de la culture philosophique allemande, et quelques universités (le cas de celle de Halle est typique) furent entièrement dominées par sa doctrine. On dit qu'à Berlin, Hegel aurait été pris d'un « vieillissement » spéculatif : rien de plus inexact, il montra dans ses cours combien ses facultés d'observation étaient encore vives, il y repensa son système et l'y renouvela avec une force inattendue. Atteint par l'épidémie de choléra qui avait fait de nombreuses victimes à Berlin, Hegel reprit cependant ses cours le 10 novembre 1831, mais il dut s'aliter le 13 et mourut le 14. Ses obsèques furent célébrées en grande pompe. Sur sa tombe, le recteur de l'Université de Berlin, Marheineke, qui fut un des disciples de Hegel, le compara dans son oraison funèbre à Jésus-Christ. Hegel fut enterré, ainsi qu'il l'avait demandé, à côté de Fichte. Le 24 avril 1930, on fonda à La Haye une « Hegel-Bund » internationale qui se réunit en congrès tous les deux ans.
De son vivant, Hegel n'avait publié qu'une petite partie de son oeuvre dont la Phénoménologie, la Science de la logique et l'Encyclopédie des sciences philosophiques ; l'essentiel de son système résidait dans les cours qu'il fit à léna, Nuremberg, Heidelberg et Berlin. A sa mort, ses amis et ses disciples entreprirent une publication de ses oeuvres complètes comprenant, reconstituée à partir des manuscrits qu'il avait laissés et surtout des notes prises a ses cours par ses élèves, la matière de son enseignement. C'est ainsi que virent le jour l'Esthétique publiée par H. G. Hotho en 1832, la Philosophie de la religion, édition préparée par Marheineke en 1832 et dans un texte plus complet en 1840; K. L. Michelet prépara les Leçons sur l'histoire de la philosophie qui virent le
jour en 1832; dans les Leçons sur la philosophie de l'histoire (1837) qui furent publiées à nouveau, complétées par le propre fils du philosophe, Karl Hegel (1840). Enfin, l'Encyclopédie des sciences philosophiques publiée du vivant de Hegel fut reprise à son tour et augmentée de très importantes additions tirées de ses cours. Von Henning compléta ainsi la Logique (1840), K. L. Michelet la Philosophie de la Nature (1842), Boumann la Philosophie de l'Esprit (1845) qui virent le jour séparément. Avec la Propédeutique philosophique, résumé des cours élémentaires, professés à Nuremberg, toutes ces oeuvres formèrent l'édition complète des oeuvres de Hegel, en dix-huit volumes publiés à Berlin de 1832 à 1845; s'y trouvaient adjoints une biographie du philosophe par Rosenkranz et un recueil de Lettres rassemblées par Karl Hegel.
Il demeurait encore quelques manuscrits de Hegel ses cours d'Iéna et d'assez nombreuses oeuvres de jeunesse. Ceux-ci furent publiés beaucoup plus tard : une partie des cours d'Iéna par G. Mollat sous le titre de Système des institutions morales [1893] et de Constitution de l'Allemagne, écrite par Hegel en 1802; les travaux de jeunesse, rédigés de 1788 à 1800, comprenant, en particulier, la Vie de Jésus, parurent sous le titre de Ecrits de jeunesse sur la théologie, édités par Nohl en 1907.
Ce n'est qu'avec l'édition critique publiée à Leipzig, à partir de 1905, par G. Lasson et J. Hoffmeister que ces différents travaux furent annexés définitivement au patrimoine hégélien. Cette nouvelle édition comprend, en outre, l'édition intégrale de tous les écrits de jeunesse dont, en trois volumes, les Cours d'iéna.
Peu d'oeuvres philosophiques ont suscité plus de discussions et d'interprétations contradictoires. Après la mort du maître, ses disciples se divisèrent en deux groupes, l'un d'eux qui constitue la droite de l'Ecole hégélienne, en revint au théisme traditionnel, l'autre, comprenant les hégéliens de gauche, aboutit à l'athéisme; ses représentants les plus remarquables furent Strauss, Feuerbach et surtout Karl Marx. Ces deux interprétations divergentes subsistèrent lorsque la doctrine de Hegel conquit l'Europe; alors qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, s'imposait, avec des penseurs tels que Green, F. H. Bradley et J. Royce, l'esprit religieux de la droite hégélienne, les hégéliens de gauche l'emportaient en Russie dans les milieux d'avant-garde et comptaient comme leur meilleur représentant A. Herzen; de nos jours ce courant de la gauche hégélienne a donné naissance, à travers Marx, au matérialisme dialectique. En France, après Victor Cousin, la doctrine de Hegel a influencé des penseurs aussi différents que Renan, Vacherot et Hamelin. En Italie, le philosophe Benedetto Croce a tenté de constituer et a défendu, au cours de sa longue carrière, un néo-hégélianisme de tendance éclectique et a précisé les positions de ce mouvement de pensée dans un ouvrage célèbre : Ce qui est vivant et ce qui est mort dans la philosophie de Hegel.
Depuis une vingtaine d'années, les études hégéliennes ont connu un renouveau qui laisse cependant subsister le fossé qui sépare la droite et la gauche de l'Ecole. Les deux courants sont représentés en France actuellement par deux exégètes de la pensée hégélienne, H. Niel qui l'interprète dans le sens du théisme chrétien et A. Kojève qui voit en elle « une philosophie radicalement athée ». Enfin les rapports de la doctrine avec les philosophies de l'existence posent encore de nouveaux problèmes et ouvrent de nouvelles discussions.
HEGEL Georg Wilhelm Friedrich. Philosophe allemand. Né à Stuttgart le 27 août 1770, mort du choléra le 14 novembre 1831 à Berlin. Une curieuse coïncidence fait naître Hegel l'année même où naquit Hölderlin; c'est ainsi que parurent ensemble dans le monde de l'Allemagne du XVIIIe siècle finissant le poète qui devait exprimer le crépuscule de cet univers et le dépasser par son oeuvre et le philosophe qui tira du romantisme ses accents les plus profonds tout en les encadrant dans une vision rationnelle complètement étrangère à l'inquiétude des romantiques. C'est en vain, toutefois, que l'on chercherait dans la première jeunesse de Hegel les traces ou le bouillonnement d'un « Sturm und Drang » : rien de plus incolore que son adolescence. Fils d'un modeste employé de l'administration ducale, il passa dix-huit ans entre maison paternelle et collège, sans briller, bien qu'il fût un modèle d'attention et de précision, ni par l'intelligence ni par l'imagination. Il lisait beaucoup, et avec une incroyable patience il faisait des extraits de tout ce qu'il avait lu. Nous possédons encore aujourd'hui une partie de ce travail soigneux dans ses cahiers de notes. En 1788, Hegel a dix-huit ans, la Révolution française est imminente et il s'est inscrit aux cours supérieurs de théologie du Séminaire de Tübingen : l'âge, la conjoncture politique, cette nouvelle ambiance accomplirent le miracle d'éveiller en lui les facultés intellectuelles qui, jusqu'alors, y sommeillaient. La connaissance qu'il fit de Hölderlin, également étudiant à Tübingen, contribua pour une large part à cet éveil de sa personnalité. Une immédiate et vive amitié s'établit entre eux. Hegel commence à écrire des méditations, des études et même une poésie, Eleusis, imitée de Hölderlin. Peut-être encore plus décisive est, deux ans plus tard, sa rencontre avec Schelling, de cinq ans son cadet, mais infiniment plus précoce et déjà connu dans les milieux intellectuels. En effet, Schelling s'inscrit aussi aux cours de Tübingen et c'est alors que s'établit entre lui et Hegel un vaste courant d'influences réciproques : Schelling avait une formation romantique, celle de Hegel était au contraire profondément classique, leur rencontre ne pouvait être que fructueuse. La « Stift » de Tübingen avait une vie bien à elle : on peut dire que c'était un moyen terme entre l'Université et le Séminaire : les élèves, en effet, habitaient dans l'institution même où ils étaient surveillés dans leurs études par les « Repetenten » dont c'était le travail. Il régnait dans cet établissement un curieux mélangé de rigueur conventuelle et de liberté universitaire : d'une part, la nourriture y était peu abondante et on y souffrait du froid, d'autre part les étudiants jouissaient d'une grande liberté de pensée et n'étaient pas tenus à la stricte orthodoxie protestante. Ces deux éléments, la rigueur des études et la liberté de pensée influèrent beaucoup sur le caractère du jeune Hegel.
En automne 1793 il obtint son diplôme en théologie, et si on le jugea bon logicien, on lui dénia tout don pour l'éloquence. Pour cette raison, Hegel renonça à la carrière de pasteur, et se dirigea vers celle de précepteur privé; c'était une carrière ennuyeuse, hérissée de difficultés et d'humiliations. Son premier poste fut celui de professeur dans la famille von Streiger, à Berne, l'une des familles les plus aristocratiques de la ville. Hegel accepta bien que ce métier lui déplût, et la solitude de Berne après la vie intense de Tübingen favorisa grandement sa formation intellectuelle. Il commença à lire (ou à relire) La Religion dans les limites de la simple raison de Kant qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait au premier abord peu comprise; elle le transporta dans un univers nouveau pour lui, bien loin de ce monde romantique qui l'avait jusque-là dominé. C'est ainsi qu'il se rapprocha très vite de la morale kantienne, qu'il lut avidement Lessing et Herder et se convertit dans son for intérieur à un rationalisme fondamental qui deviendra la caractéristique de sa philosophie. Le premier fruit de son changement d'orientation est la célèbre Vie de Jésus v. Ecrits de jeunesse sur la théologie rationaliste, et restée inédite jusqu'au XXe siècle. En 1797, Hegel est encore précepteur à Francfort-sur-le-Main, et là, il cherche à concilier les deux tendances et les deux influences opposées qui s'agitaient dans son esprit, d'une part le romantisme dont il s'était imprégné à Tübingen, et de l'autre le rationalisme qui s'était développé en lui au cours de ses méditations solitaires de Berne. L'année suivante se produisait un événement très important : son ami Schelling fut nommé professeur « extraordinaire », sur la recommandation de Niethammer, Fichte et Goethe, à la célèbre université d'Iéna. Cette petite ville était désormais devenue l'un des centres culturels les plus actifs de toute l'Allemagne, grâce surtout à l'oeuvre de Reinhold et de Fichte. Autour d'eux se pressaient un grand nombre de « Privatdozenten » dont quelques-uns promis à la renommée, comme Fries, Krause et d'autres. Mais en 1799-1800 éclata le fameux « Atheismusstreit » (ou débat sur l'athéisme) et Fichte est contraint de quitter léna qui, dès lors, commence à décliner. C'est justement au cours de ces années de discussions, en janvier 1801, que Hegel fut appelé à enseigner à léna, sur la recommandation de Schelling : à partir de ce moment s'ouvrit une ère d'amitié et de collaboration des plus intenses entre Hegel et Schelling. Les articles si connus les plus importants de Hegel sont Foi et science et Sur la méthode scientifique du droit naturel - parus dans le Kritisches Journal der Philosophie, dont ils étaient les directeurs, et dans lesquels Hegel prit la défense de la philosophie de Schelling contre celle de Fichte, en sont les produits. Pendant ce temps, Hegel, dans ses cahiers de notes, expose son système. En effet, le climat universitaire de Iéna a définitivement achevé sa formation spirituelle, les énergies qui étaient latentes en lui se sont ouvertes et développées, et, tandis que Schelling, l'« enfant prodige », bien plus jeune que lui, va vers le déclin, Hegel est sur le point de produire ses meilleures oeuvres. La première d'entre elles ne tarde guère : c'est la célèbre Phénoménologie de l'esprit ; Hegel avait promis de la remettre à l'éditeur en octobre 1806, mais l'occupation d'Iéna par les Français retarda son travail qui fut conclu hâtivement l'année suivante : c'est dans cet état qu'il fut publié à Bamberg et à Würzburg. Dans la préface remarquable de cette oeuvre on note la rupture définitive de Hegel avec les romantiques et avec Schelling.
Après la chute d'Iéna, Hegel connut des difficultés financières et, pour vivre, fut obligé d'accepter l'ingrate tâche de rédiger un quotidien de province, le Bamberger Zeitung. Il fut contraint de demeurer dans cette petite ville sans culture jusqu'en 1808, écrivant à ses amis des lettres remplies d'amertume, jusqu'au jour où, pour le tirer de cette situation difficile, intervint son ami, et aussi celui de Schelling, le puissant Niethammer. Celui-ci avait, justement pendant ces dernières années, mis en oeuvre un projet de réforme des lycées de la Bavière, Hegel fut donc envoyé à Nuremberg, comme proviseur du nouveau lycée classique ou il professa également la philosophie. Ce furent sans doute les années les plus tranquilles et les plus laborieuses de son existence. Il épousa, en 1811, une jeune fille appartenant à la meilleure noblesse de la ville, et il donna, pendant cette période, la Science de la logique et la Propédeutique philosophique [Philosophische Propadeutik]. Cependant la direction d'un lycée ne pouvait être une position adaptée à la valeur et aux ambitions de Hegel; il aspirait à l'enseignement universitaire, et cette aspiration fut satisfaite en 1816, lorsqu'il fut appelé à enseigner la philosophie à l'Université de Heidelberg. Là, il commença à former son école : autour de lui se réunit tout un groupe de disciples, dont quelques-uns, très fidèles, divulgueront son oeuvre dans toute l'Allemagne : Hinrichs, Rosenkranz, Erdmann. Et c'est alors qu'il écrit l'oeuvre qui lui vaudra le plus de gloire : l'Encyclo-pédie des sciences philosophiques; désormais le nom de Hegel circule dans tous les milieux philosophiques, suscitant de chaleureuses approbations mais aussi de violentes réactions. Sa renommée allait toujours croissant et lui fit atteindre le sommet de sa carrière professorale, l'Univer-sité de Berlin : on l'y appela au cours de l'été 1818 et il y enseigna pendant treize ans, jusqu'à sa mort. Durant ses années berlinoises, il fit paraître notamment les Principes de la philosophie du droit (1818) et les Leçons sur la philosophie de l'histoire. Hegel connut les plus grandes satisfactions qu'ait jamais obtenues un philosophe, on accourait de toute l'Allemagne pour assister à ses cours, il fut en rapport avec les plus hautes personnalités littéraires et scientifiques du temps, parmi lesquelles Goethe et Victor Cousin. Il devint peu à peu le maître de la culture philosophique allemande, et quelques universités (le cas de celle de Halle est typique) furent entièrement dominées par sa doctrine. On dit qu'à Berlin, Hegel aurait été pris d'un « vieillissement » spéculatif : rien de plus inexact, il montra dans ses cours combien ses facultés d'observation étaient encore vives, il y repensa son système et l'y renouvela avec une force inattendue. Atteint par l'épidémie de choléra qui avait fait de nombreuses victimes à Berlin, Hegel reprit cependant ses cours le 10 novembre 1831, mais il dut s'aliter le 13 et mourut le 14. Ses obsèques furent célébrées en grande pompe. Sur sa tombe, le recteur de l'Université de Berlin, Marheineke, qui fut un des disciples de Hegel, le compara dans son oraison funèbre à Jésus-Christ. Hegel fut enterré, ainsi qu'il l'avait demandé, à côté de Fichte. Le 24 avril 1930, on fonda à La Haye une « Hegel-Bund » internationale qui se réunit en congrès tous les deux ans.
De son vivant, Hegel n'avait publié qu'une petite partie de son oeuvre dont la Phénoménologie, la Science de la logique et l'Encyclopédie des sciences philosophiques ; l'essentiel de son système résidait dans les cours qu'il fit à léna, Nuremberg, Heidelberg et Berlin. A sa mort, ses amis et ses disciples entreprirent une publication de ses oeuvres complètes comprenant, reconstituée à partir des manuscrits qu'il avait laissés et surtout des notes prises a ses cours par ses élèves, la matière de son enseignement. C'est ainsi que virent le jour l'Esthétique publiée par H. G. Hotho en 1832, la Philosophie de la religion, édition préparée par Marheineke en 1832 et dans un texte plus complet en 1840; K. L. Michelet prépara les Leçons sur l'histoire de la philosophie qui virent le
jour en 1832; dans les Leçons sur la philosophie de l'histoire (1837) qui furent publiées à nouveau, complétées par le propre fils du philosophe, Karl Hegel (1840). Enfin, l'Encyclopédie des sciences philosophiques publiée du vivant de Hegel fut reprise à son tour et augmentée de très importantes additions tirées de ses cours. Von Henning compléta ainsi la Logique (1840), K. L. Michelet la Philosophie de la Nature (1842), Boumann la Philosophie de l'Esprit (1845) qui virent le jour séparément. Avec la Propédeutique philosophique, résumé des cours élémentaires, professés à Nuremberg, toutes ces oeuvres formèrent l'édition complète des oeuvres de Hegel, en dix-huit volumes publiés à Berlin de 1832 à 1845; s'y trouvaient adjoints une biographie du philosophe par Rosenkranz et un recueil de Lettres rassemblées par Karl Hegel.
Il demeurait encore quelques manuscrits de Hegel ses cours d'Iéna et d'assez nombreuses oeuvres de jeunesse. Ceux-ci furent publiés beaucoup plus tard : une partie des cours d'Iéna par G. Mollat sous le titre de Système des institutions morales [1893] et de Constitution de l'Allemagne, écrite par Hegel en 1802; les travaux de jeunesse, rédigés de 1788 à 1800, comprenant, en particulier, la Vie de Jésus, parurent sous le titre de Ecrits de jeunesse sur la théologie, édités par Nohl en 1907.
Ce n'est qu'avec l'édition critique publiée à Leipzig, à partir de 1905, par G. Lasson et J. Hoffmeister que ces différents travaux furent annexés définitivement au patrimoine hégélien. Cette nouvelle édition comprend, en outre, l'édition intégrale de tous les écrits de jeunesse dont, en trois volumes, les Cours d'iéna.
Peu d'oeuvres philosophiques ont suscité plus de discussions et d'interprétations contradictoires. Après la mort du maître, ses disciples se divisèrent en deux groupes, l'un d'eux qui constitue la droite de l'Ecole hégélienne, en revint au théisme traditionnel, l'autre, comprenant les hégéliens de gauche, aboutit à l'athéisme; ses représentants les plus remarquables furent Strauss, Feuerbach et surtout Karl Marx. Ces deux interprétations divergentes subsistèrent lorsque la doctrine de Hegel conquit l'Europe; alors qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, s'imposait, avec des penseurs tels que Green, F. H. Bradley et J. Royce, l'esprit religieux de la droite hégélienne, les hégéliens de gauche l'emportaient en Russie dans les milieux d'avant-garde et comptaient comme leur meilleur représentant A. Herzen; de nos jours ce courant de la gauche hégélienne a donné naissance, à travers Marx, au matérialisme dialectique. En France, après Victor Cousin, la doctrine de Hegel a influencé des penseurs aussi différents que Renan, Vacherot et Hamelin. En Italie, le philosophe Benedetto Croce a tenté de constituer et a défendu, au cours de sa longue carrière, un néo-hégélianisme de tendance éclectique et a précisé les positions de ce mouvement de pensée dans un ouvrage célèbre : Ce qui est vivant et ce qui est mort dans la philosophie de Hegel.
Depuis une vingtaine d'années, les études hégéliennes ont connu un renouveau qui laisse cependant subsister le fossé qui sépare la droite et la gauche de l'Ecole. Les deux courants sont représentés en France actuellement par deux exégètes de la pensée hégélienne, H. Niel qui l'interprète dans le sens du théisme chrétien et A. Kojève qui voit en elle « une philosophie radicalement athée ». Enfin les rapports de la doctrine avec les philosophies de l'existence posent encore de nouveaux problèmes et ouvrent de nouvelles discussions.
ARMANDO PLEBE.
? « Il attire la religion chrétienne dans la philosophie, alors qu'elle n'y a que faire... Les jugements de Hegel, comme critique, ont toujours été excellents. » Goethe. ? « Goethe tient Hegel personnellement en très haute estime, quand bien même certains fruits issus de sa philosophie ne lui plaisent guère.» Conversations de Goethe avec Eckermann, 18 octobre 1827. « ... je ne demande grâce que pour la France. Hegel, dites-moi la vérité, puis j'en passerai à mon pays ce qu'il en pourra comprendre... » (1826) « Son visage était l'image de sa pensée. Ses traits prononcés et sévères, mais tranquilles et sereins, son parler lent et rare, mais ferme, son regard calme mais décidé, tout en lui était l'emblème d'une réflexion profonde, d'une conviction parfaitement arrêtée, exempte de toute incertitude et de toute agitation, arrivée à la paix du plus absolu dogmatisme... Il demeurait une sorte de philosophe du XVIIIe siècle... Il ne dissimulait pas sa sympathie pour les philosophes du dernier siècle, même pour ceux qui avaient le plus combattu la cause du christianisme et celle de la philosophie spiritualiste. » Victor Cousin. ? « Ma méthode dialectique, non seulement diffère par la base de la méthode hégélienne, mais elle en est même l'exact opposé... puisque je suis matérialiste et Hegel idéaliste. La dialectique de Hegel est la forme fondamentale de toute dialectique, mais seulement lorsqu'elle a été débarrassée de sa forme mystique, et c'est précisément cela qui distingue ma méthode... Bien que, grâce à son quiproquo, Hegel défigure la dialectique par le mysticisme, ce n 'en est pas moins lui qui en a le premier exposé le mouvement d'ensemble. Chez lui, elle marche sur la tête; il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver la physionomie tout à fait raisonnable. » Karl Marx. ? « Ce que les dogmatiques hégéliens appellent foi n'est rien d'autre en définitive que cette immédiateté première, cette disponibilité pour toute chose le fluide vital l'atmosphère que nous respirons... Dans ces conditions, la foi se trouve en quelque sorte rabaissée au niveau du sentiment, de l'humeur, des réactions individuelles... Singulière, la haine, visible dans tous ses écrits, qu'eut Hegel pour toute entreprise d'édification. Mais être édifiant, ce n'est pas donner un opium pour bercer le sommeil, c'est prononcer l'amen de l'Esprit infini et c'est un aspect de la connaissance qui ne devrait pas être surveillé. » Kierkegaard. + « La dernière conclusion de la philosophie allemande [c'est-à-dire Hegel] veut prouver que l'homme est obligé de faire l'histoire sans la conduite et la protection d'un Dieu, que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, mais que c'est l'homme qui a imaginé Dieu. Si cet enseignement révolutionnaire prenait racine dans les cerveaux allemands, il en serait bientôt fini du calme lourd, de la vénération de l'autorité, de l'ingénuité qui avaient caractérisé jusqu'alors la vie allemande. La philosophie allemande constitue une déclaration de guerre à la réalité allemande et recèle des promesses révolutionnaires. Mais rien ne prouve que cette révolution serait aussi généreuse, libératrice et universelle que l'avait été la Révolution française. » Henri Heine. ? « La logique de Hegel, telle que je la comprends, satisfait infiniment plus ma raison que tous les vieux apophtegmes dont on nous a bourrés dès l'enfance. » Proudhon, 1846. ? « Quant à Hegel, je suis vraiment bien heureux que vous ayez accordé quelque attention à ce miraculeux génie, à ce procréateur sans pareil, à ce reconstructeur de l'univers.» Villiers de l'Isle-Adam, lettre à Mallarmé, septembre 1868. ? « Hegel a du bon, mais il faut savoir le prendre : c'est un thé excellent, mais il ne faut pas mâcher les feuilles. » Renan, à la fin de sa vie. ? « Il a la tête d'un tenancier de brasserie.» Schopenhauer. ? « Hegel, qui passa délibérément à travers toutes les habitudes logiques, bonnes et mauvaises, lorsque osa enseigner que les idées spécifiques se développent l'une par l'autre : un principe, par quoi, en Europe, les esprits furent préparés au dernier grand mouvement philosophique, au darwinisme car sans Hegel, point de Darwin... Nous autres, Allemands, nous serions hégéliens même si Hegel n'avait jamais existé, dans la mesure où (en opposition avec tous les Latins) nous accordons instinctivement un sens plus profond, une valeur plus riche au devenir, à l'évolution qu'à ce qui est. » Nietzsche. ? « Toute sa vie, il demeura le Souabe bonhomme et raide, au travail régulier et tenace, l'homme d'intellectualité pure, sans vie extérieure, l'homme à l'imagination interne puissante, sans charme et sans sympathie, le bourgeois aux vertus modestes et ternes, et, par-dessus tout, le fonctionnaire ami de la force et de l'ordre, réaliste et respectueux. » Lucien Herr. ? « L'expérience religieuse de Hegel, c'est, amplifiée à travers tous les domaines de la spéculation et de la pratique, l'expérience du Verbe, de l'unité qui, grâce à la fonction médiatrice de la raison, s'établit entre le fond éternel de l'être et la réalité de la nature et de l'histoire. » L. Brunschwicg. ? « Il était de ceux qui n'ont jamais connu la spontanéité naïve de la jeunesse mais chez qui, même dans la vieillesse, brûle un feu caché. » Dilthey. ? « La conscience moderne ne peut ni accepter Hegel tout entier, ni le repousser tout entier, comme on le faisait il y a cinquante ans : elle se trouve vis-à-vis de lui dans la situation du poète romain vis-à-vis de sa femme : « nec tecum vivere possum, nec sine te... » Il fallait... en conserver la partie vitale, c'est-à-dire la conception du concept, l'universel concret, avec la dialectique des contraires et la théorie des degrés de la réalité; repousser, en s'appuyant sur cette nouvelle conception, et en la développant, tout panlogisme et toute construction spéculative de l'individuel et de l'empirique, de l'histoire et de la nature; reconnaître l'autonomie des diverses formes de l'esprit, même dans leur nécessaire connexion et unité; et enfin, résoudre toute la philosophie en une pure philosophie de l'esprit... » Benedetto Croce, 1909. ? « Hegel peut tenir lieu d'Aristote, car c'est l'Aristote des temps modernes, le plus profond des penseurs et celui de tous qui a pesé le plus sur les destinées européennes. » Alain.
Liens utiles
- Georg Hegel Georges Friedrich Wilhelm Hegel naquit en 1770 à Stuttgart.
- lecture linéaire candide ou l'optimisme: l’idée du philosophe allemand Leibniz, selon laquelle tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible
- Hegel, le grand philosophe des temps modernes, a écrit que la lecture du journal était la prière du matin. Commentez et discutez s'il y a lieu.
- « Hegel, le grand philosophe des temps modernes, a écrit que la lecture du journal était la prière du matin. Commentez et discutez s'il y lieu ».
- Idéalisme allemand / Hegel































