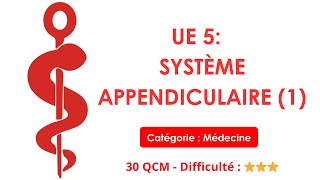Catégorie : Médecine
- Glucides: les hétérosides
-
LE NERF RADIAL
LE NERF RADIALI. ORIGINE DU NERF RADIAL. 1) Origine apparente. Le nerf radial nat du faisceau postrieur (ou tronc secondaire postrieur) QCM! du plexus brachial. A son origine, il est donc situ en arrire de lÕartre axillaire. Ceci est facile retenir car le nerf radial innerve tous les muscles extenseurs du membre suprieur, cÕest dire tous les muscles situs la face postrieure du bras et de lÕavant-bras; il est donc logique quÕil provienne du faisceau postrieur du plexus brachial...
-
LES CHROMOSOMES
1/3 LES CHROMOSOMES I. CRITERES D'IDENTIFICATION DES CHROMOSOMES. Quelle que soit la cellule considre appartenant un tissu do nn, un chromosome a toujours la mme forme et les mmes caractres. Chaque chromosome est identifiable par : å lÕindice centromrique (qui dpend de l'emplacement du centromre sur la chromatide) å les constrictions secondaires å les tlomres å les satellites å les bandes. A. L'indice centromrique. Le centromre occupe une place diffrente d'un type de...
-
LES LYSOSOMES
1/4 LES LYSOSOMES I. GENERALITES. Les lysosomes sont des structures vsiculaires arrondies, limites par une membrane lipoprotique classique. Leur diamtre moyen est de 0,4 µm, ils sont donc visual isables en microscopie optique. Ils sont prsents dans toutes les cellules lÕ exception des hmaties, et sont particulirement nombreux dans les cellules activit macrophagique tels les granulocytes, les histiomonocytes... Ils sont caractriss par : - une forte concentration en phosphatases...
- L'OS OCCIPITAL (PACES)
-
HEMATIE (PACES)
HEMATIE Les hmaties sont hypoosmotiques: 20 mosmol/ L D = 0,50 LÕosmolarit du plasma peut tre obtenu par: - srum sal isotonique: NaCL 9 ä = 58,2/2 = 0,305 - srum glucos 5 % (0,305 x 180) Þ isotonique ou isosmotique au plasma. * Si lÕhmatie est dans de lÕeau pure, comme elle est hypoosmoti que, il y a turgescence des hmaties puis hmolyse par entre dÕeau dans la cellule. * Si lÕhmatie est dans un srum hyperosmotique (ex: glucos 30%), il y a plasmolyse, cÕest di...
-
GAMÉTOGENÈSE
1 / 2 GAMÉTOGENÈSE I/ OVOGENÈSE I-1/ MUL TIPLICATION (OVOGONIE S) ET DÉGÉ NÉ RE S C E NCE I-2/ ACCROISSEMENT I-2-1/ PETIT AC CR OISSEM ENT-PR ÉM ÉÏO SE -OVOCYTES I (2n) I-2-2/ GRAND ACCROI SSEMENT I-2-3/ ACCROI SSEMENT RAPIDE - C YTODIFFÉRENCIATION I-3/ MATURATION I-3-1/ PR EM IÈR E DI VISION D E M ÉÏO SE -OVO CYTE II (n) ET PREMI ER GLOBULE POLAIRE I-3-2/ SECO N D E DI VI SIO N D E MÉÏO SE -ARRÊT EN MÉTAPHASE II -P ONTE OVULAIRE -ACTIVATION PAR UN SPERMATOZOÏDE -OVOTIDE I-4/...
-
TOTIPOTENCE
1 / 2 • TOTIPOTENCE LA CELLULE TOTIPOTENTE PEUT DONNER NAISSANCE A TOUS LES TYPES CELLULAIRES D’UN ORGANISME (ET MEME A L’ORGANISME ENTIER) INDICE MITOTIQUE ELEVE PAS DE CARACTERES MORPHOLOGIQUES SPECIALISES GENOME LARGEMENT INEXPRIME ET TRES ACCESSIBLE A TOUS LES MECANISMES DE CONTRÔLE AUXQUELS IL REPOND RAPIDEMENT 2 / 2
-
-
CHROMATOGRAPHIE
Il CHRO MATOG R AP HI E Il Prin ci pe : Sé parati o n d e petit es m ol éc ul es (acide s aminé s, nucl éo tides, oses ... ) ou d e m a cr om ol éc ul es (m élan ge d e pr oté in es) au se in d'l ph as e m obil e qui circule sur un suppo rt s o lid e. C rit è res de sé p ara ti on : ~ so lubilit é, ad sorpti on ~ P M (taill e) ~ char ges él ec:.t riqu es ~ aflinité s ... D eu x grand s ty p es de c hr omat ogra phi e : ~ chr omat...
-
LA MITOSE
1/7 www.mediprepa.com LA MITOSE Toutes les cellules dÕun mme organisme pluricellulaire sont issues par division cellulaire dÕune unique cellule initiale (zygote chez les animaux, graine chez les vgtaux et spores chez les champignons). Flemming, en 1882, donna une dfinition de ce processus de division cellulaire pour les cellules animales et qui fut tendue par la suite aux cellules vgtales et la plupart des cellules eucaryotes (...
-
LA MÉÏOSE
1 / 2 LA MLA M ÉÏÉÏ OSEOSE •• I/ PLACE DANS LA REPRODUCTION SEXUI/ PLACE DANS LA REPRODUCTION SEXU ÉÉ EE •• II/ DII/ D ÉÉ ROUL EMEN T DE LA M ROUL EMEN T DE LA M ÉÏÉÏ OSE OSE -- ASPECTS MORPHOLOG IQUES ASPECTS MORPHOLOG IQUES •• IIII --1/ PR E M I 1/ PR E M IÈÈ RE DIVISION DE MRE DIVISION DE M ÉÏÉÏ OS E OS E •• IIII --11 --1/ PROPHAS E I 1/ PROPHAS E I •• --L EPTOT L EPTOT ÈÈ NENE •• --ZYGOTZYGOT ÈÈ NENE •• --PAC H Y T PAC H...
-
L'avant-bras
1 Médecine première année Anatomie L'avant-bras suite du cours sur le membre thoracique. I. Topologie 1. Les limites a. Limite supérieure. Ligne horizontale qui passa trois travers de doigts au-dessus du relief des épicondyles. b. Limite inférieure Ligne horizontale qui passe à deux travers de doigts au-dessus du processus styloïde du radius ( relief le plus marqué présent à la face latérale du poignet) 2. Organisation générale de l'avant-bras a. Le squelette de l'avant-bras. Le sque...
-
LE LARYNX
LE LARYNX (2) I. GENERALITES. II. LES PIECES CARTILAGINEUSES. A. Le cartilage thyrode. B. Le cartilage cricode. C. Le cartilage piglottique. D. Le cartilage arytnode. III. LES MOYENS DÕUNION. A. La membrane thyro-hyodienne. B. La membrane crico-thyrodienne. C. Les autres moyens dÕunion. IV. LES MUSCLES INTRINSEQUES DU LARYNX. A. Le muscle crico-thyrodien. B. Les muscles inter-arytnodiens. C. Les muscles ÒlatrauxÓ. Les muscles du bord latral sont nombreux et organiss en p...
-
LA MANDIBULE
LA MANDIBULE I. GENERALITES. La mandibule est le seul os impair et mobile du massif facial. Elle drive de 2 moitis de mandibule qui se soudent pendant la p riode fÏtale. Elle sÕarticule avec les deux os temporaux. LÕos est form dÕun corps et de deux branches (ou ramus): 1) Le corps a la forme forme dÕun cube ouvert en arrire, 2) Les branches viennent se brancher sur le corps. Ce sont 2 parties paisses qui se dirigent en haut et en arrire. Ce sont elles qui vont sÕarticuler avec les os...
-
STEREOCHIMIE
STEREOCHIMIE Une formule dveloppe plane nÕest pas toujours suffisante pour dcrire convenablement une molcule. Vous connaissez certainement dj certaines formes dÕisomrie : de constitution, fonctionnelle. Ici, nous nous intresserons plus particulirement la stroisomrie. Cette isomrie est lie la forme du carbone : vous savez certainement que les liaisons autour du carbone sÕorganisent dans une pyramide base triangulaire. CÕest cet arrangement dans lÕespace qui est lÕorigine...
-
LE PHARYNX
LE PHARYNX I. GENERALITES. Le pharynx est une gouttire verticale dans laquelle sÕouvre 3 cav its: - la cavit nasale, en haut - la cavit orale, au milieu - le larynx, par son aditus laryng, en bas. Il se poursuit avec lÕÏsophage en C6. Les muscles constricteurs ont une disposition transversale, alors que le s muscles lvateurs ont une disposition verticale. Cette couche musculaire est prise en sandwich entre 2 fascias: - le fascia intra-pharyngien, lÕintrieur, - le fascia pri-pharyng,...
-
-
LA LANGUE
LA LANGUE I. GENERALITES. La langue est un organe musculo-muqueux qui occupe lÕessentiel de la cavit orale. CÕest un organe sensoriel par sa muqueuse o sigent les papill es linguales; elle sert donc la gustation. Par sa musculature puissante qui va lui confrer une grande mobilit , elle va participer de nombreuses fonctions: - la mastication, - la dglutition, - la phonation. Elle est recouverte par une muqueuse linguale: - celle-ci est en continuit avec la muqueuse de la gencive, -...
-
LE PERICARDE
LE PERICARDEI. GENERALITES. Le pricarde est un sac sreux dans lequel le cÏur bat librement, lÕexception de ses points dÕattache que reprsentent les pdicules artriel et veineux. Ce pricarde sreux est form de 2 feuillets se poursuivant lÕun avec lÕautre au niveau de lignes de rflexion: ¶ la lame viscrale (ou picarde) (= contre le viscre) tapisse la face externe du cÏur et la partie initiale des vaisseaux qui y entrent ou qui en sortent. Elle passe en pont au-dessus des sillons du...
-
L'OS HYOÏDE
LÕOS HYOìDE I. GENERALITES. SITUATION. Il vient se placer au dessous et en dedans de la moiti postrieur e de la mandibule. Il est aisment palpable, juste en dessous de la mandibule et au dess us de la pomme dÕAdam. Il est suspendu la base du crne par un appareil osto-ligame ntaire. On voit se dtacher du sommet du processus stylode un ligament qu i rejoint la petite corne de lÕos hyode, cÕest le ligament stylo hyodien. CÕest grce lui que l Õos est suspendu la base du crne. C...
-
Le cancer
Malgré les progrès incessants faits tant en matière de traitement que de détection et de prévention, le cancer reste une des maladies les plus angoissantes pour la plupart d'entre nous. En effet l e cancer est la première cause de mortalité en France, devant les pathologies cardiovasculaires. Les personnes agées sont le plus souvent touchées mais le cancer peut se répandre aussi chez les enfants et représente la deuxième cause de mortalité avant 14 ans. Mais qu’est ce que le cancer plu...