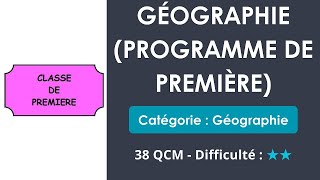BECKETT Samuel
BECKETT Samuel. Ecrivain irlandais d’expression anglaise et française. Né à Dublin le 13 avril 1906. Issu d’une famille protestante, il est successivement pensionnaire à la « Portora Royal School » d'Einiskillen, puis élève du « Trinity College » de Dublin, où il étudie le français. En 1928, Beckett est nommé lecteur d’anglais à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, et fait la connaissance de James Joyce. En 1930, il traduit avec Alfred Péron Anna Livia Plurabelle de Joyce [fragment de la future Veillée de Fonnegan]. De 1931 à 1937, il effectue de nombreux voyages, résidant tantôt en France, tantôt en Angleterre. Mais à partir de 1938, il se fixe définitivement à Paris. Jusqu’à la guerre, Beckett avait écrit ses livres — Dante... Bruno... Vico... Joyce [Dante... Bruno... Vico... Joyce, 1929], Whoroscope (1929), Plus de coups d’épingles que de coups de pieds (1934), Notre Examen au sujet de sa « factification » dans la mise en route de l’œuvre en Progrès et Murphy (1938) en anglais. Après 1945, il commence à traduire ses ouvrages antérieurs — et notamment Murphy — en français, et à écrire des poèmes et des nouvelles dans cette langue. En 1953, En Attendant Godot est représenté à Paris au Théâtre de Babylone, dans une mise en scène de Roger Blin. Cette pièce connaît immédiatement un immense succès et signale le début de la carrière théâtrale de Beckett. C’est également grâce à ses pièces que Beckett acquiert une réputation croissante, qui conduit en 1969 à l'attribution du Prix Nobel de Littérature. L’œuvre de Samuel Beckett est très abondante. Citons d’abord les romans et les récits (pour la plupart écrits en français) : Murphy, Molloy (1951), Malone meurt (1952), L’Innommable (1953), Nouvelles et textes pour rien (1955), Comment c’est (1961), Imagination morte, imagine (1965), Têtes mortes (1967), Watt (1969), Premier amour (1970), Le Dépeupleur (1971), Film, suivi de Souffle (1972), Pas moi (1975), ainsi que divers textes comme Acte sans paroles, Assez, Cascando, Cendres (1958), Dis Joe, D’un ouvrage abandonné, Va et vient (1966). Les pièces de théâtres, moins nombreuses, sont mondialement connues : En attendant Godot, Fin de partie, Tous ceux qui tombent (1957), La Dernière bande (1960), Oh les beaux jours (1963), Comédie (1963), Comédie et actes divers (pièce radiophonique, 1964). Œuvre « théâtrale » et œuvre « romanesque » témoignent chez Beckett de la même visée centrale : atteindre une nudité de langage, ou plus exactement de parole, qui dise comme à ras de terre la condition humaine. C’est cette visée qui donne à ses textes à la fois leur vérité universelle et un dépouillement presque abstrait. Qu’il s’agisse des pièces, des romans ou des nouvelles, la thématique est apparemment la même, apparemment indéfiniment répétitive : le temps humain, l’attente, la quotidienneté, la solitude, l’aliénation, la mort, l’errance, la non-communication, la déchéance, et aussi — plus rarement — l’espoir, le souvenir, le désir. Beckett ne parle « que » de cela. Mais ce ne sont pas ces thèmes qui définissent son œuvre, son écriture : c’est le langage employé Four les dire, les « mettre en scène ». Certes, œuvre propose, surtout en ses débuts, des « histoires », des personnages : le théâtre, en particulier, nous présente une galerie de clochards, d’errants, de vieillards, de clowns ou de malades qui sont devenus aussi célèbres que le Roi Lear ou Hamlet de Shakespeare. Mais ces personnages n’ont pas de psychologie, pas d’individualité au sens classique : ce sont des ombres, des figures, des incarnations d’une certaine condition humaine, et surtout, ce sont des voix. Tout texte de Beckett est d’abord l’émergence, sur une certaine scène, dans un certain espace (et de là sa parenté profonde avec le théâtre), de voix, voix qui peuvent être uniques, ou multiples, ou quasi anonymes, mais qui ne cessent de parler, comme si parler, pour elles, équivalait à être, à subsister, à continuer malgré l’effondrement de tout. Ces voix ne rompent pas le silence universel qui les entoure, elles sont. Elles ne disent rien, ne proposent rien, ne racontent rien : elles parlent comme les bouches respirent. Ainsi parle la voix de L’Innommable : « Il faut donc continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a, il faut les dire, jusqu’à ce qu’ils me trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent, étrange peine. Il y a complète désintégration. Pas de Je, pas de Avoir, pas de Etre, pas de nominatif, pas d’accusatif, pas de verbe. Il n’y a pas moyen de continuer... A la fin de mon œuvre, il n’y a rien que poussière : le nommable... » Et dans Textes pour rien : « C’est avec mon sang que je pense... C’est avec mon souffle que je pense... Les mots aussi, lents, le sujet meurt avant d’atteindre le verbe, les mots s’arrêtent aussi. Mais je parle plus bas, chaque année un peu plus bas. Peut-être. Plus lentement aussi, chaque année un peu plus lentement... » Cette voix à ras de terre, à ras de corps et — pour employer un paradoxe — à ras de parole, paraît éternellement sur le point de se taire, de s’éteindre, de s’engloutir dans le silence, c’est-à-dire dans le néant. Et pourtant, elle ressurgit : « La voix qui s’écoute comme lorsqu'elle parle, qui s écouté se taire, ça fait un murmure, ça fait une voix, une petite voix, la même voix petite, elle reste dans la gorge, revoilà la gorge, revoilà la bouche. » De là vient que la nudité de plus en plus désolée de ces textes, la pauvreté de plus en plus accusée de leurs thèmes, fassent toucher à une sorte d’universel et dégagent, à mesure même que l’œuvre se resserre et se répète dans son espace, une sensation de vie et d’espoir. On a cherché dans les livres et les pièces de Beckett une « métaphysique de la condition humaine ». Bien qu’il y ait chez lui, certes, une véritable intensité métaphysique, « existentielle », il faut la chercher la ou elle se trouve, c’est-à-dire au niveau du langage. Dans Têtes mortes, Beckett fait ce surprenant aveu : « J’ai l’amour du mot, les mots ont été mes seuls amours, quelques-uns. » Ailleurs, il évoque ce qui pourrait être sa tâche la plus secrète : « Issu de l’impossible voix l’infaisable être. » Pour exprimer son expérience de la nudité du langage et de l’existence, il a créé un néologisme anglais, pratiquement intraduisible : la Lessness (la « Sanséité », la « Moinsité »). Beckett avance, creuse dans le « moins », mais ce « moins » n’est jamais équivalent à un « rien ». La même voix devient, au fil des textes, de plus en plus petite, elle s’approche de plus en plus du silence, devient silence sans cesser d’être voix : « C’est ’e silence et ce n’est pas le silence, il n’y a personne et il y a quelqu'un. » (Textes pour rien). Rarement écrivain a été aussi rigoureux, aussi fidèle à l’espace vital dans lequel il écrit. Rarement écriture a été aussi proche de la voix et du corps, et en même temps aussi abstraite (sans jamais être intellectuelle). Joyce, le lointain maître de Beckett, écrivait dans Ulysse : « L’Histoire est un cauchemar dont je souhaite m’échapper. » Beckett, dans son œuvre, a échappé à l’Histoire : tout ce qui se passe dans ses textes s’est réduit aux dimensions d’un être qui n’est nulle part, insituable et insitué, au-delà ou en deçà de l’Histoire. Peut-être a-t-il été aidé en cela par le passage de l’anglais au français, phénomène sans doute rarissime dans la littérature mondiale : cas singulier que celui d’un écrivain qui abandonne sa langue maternelle et en adopte une autre pour s’exprimer et bâtir son œuvre. Le français de Beckett, du reste, est comme sans lien avec le français des œuvres littéraires de ce siècle. Venue d’ailleurs, l’œuvre de Beckett ne saurait s’insérer dans l’histoire de la littérature moderne française : comme la voix qu’elle laisse parler, comme ses personnages égarés ou agonisants, elle est sans lieu : en ceci, elle est bien l’image de l’universel déracinement moderne, et c’est ce qui explique l’insolite succès qu’elle a connu, en dépit de la singularité de sa démarche et de la relative difficulté de ses textes. Il n’y a sans doute qu’un seul écrivain, en ce siècle, que l’on pourrait comparer à Beckett (ou dont l’œuvre soit entourée de la même solitude) et c’est Henri Michaux. Mais dans l’œuvre de Michaux, c’est encore et toujours Michaux qui nous parle, du fond de son essentielle étrangeté. Dans l’œuvre de Beckett, ce qui nous parle, ce n’est pas un certain Samuel Beckett, né à Dublin, etc., mais une voix qui est d’une certaine manière la Voix de tous, la Voix de l’Homme, des Hommes, de Tous les Hommes : « J’ai à parler, écrit Beckett dans L'Innommable, n'ayant rien à dire, rien que les paroles des autres. » Avoir su écrire les « paroles des autres », de n’importe quel autre en n’importe quel pays, dans le nulle part de l’existence souffrante et profonde, telle est la grandeur de cette œuvre.
♦ «La force corrosive de Beckett... ne saurait procéder de l’affirmation d'une quelconque conviction ou illustration d'une conception philosophique ou métaphysique. Il ne croit rien, il ne pense rien, il montre. Et ce qu’il montre, c’est l'homme privé de toute illusion, débarrassé des sentiments, croyances, pensées qui servent à lui masquer la réalité de son supplice, attaché à vivre intensément ce supplice, c’est-à-dire à souffrir, décapé jusqu’à l’os... » Maurice Nadeau.